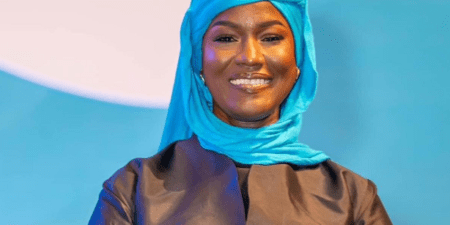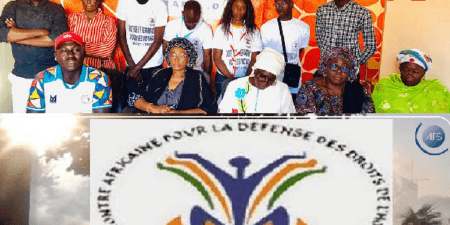Un collectif d’associations et d’universitaires demande au président de la République qu’un grand débat parlementaire soit lancé, qui donne aussi la parole avec aux sociétés civiles des pays concernés.
L’année 2022 marque un retour brutal des enjeux internationaux dans le débat public sous l’effet d’une guerre en Ukraine qui alimente conflits, instabilité et de potentielles crises alimentaires un peu partout dans le monde. Après un cycle électoral majeur en France, c’est aussi vers le Sahel et l’Afrique que l’attention des nouvelles autorités doit se tourner.
Car, depuis bientôt dix ans, c’est dans cette région que l’investissement militaire et diplomatique français a été le plus marqué – à commencer par les décès de plus de cinquante de ses soldats – et c’est là que pourrait se jouer plus largement une bonne partie de l’avenir de la relation de la France avec le continent.
Or les évènements survenus ces derniers mois n’ont fait que renforcer le constat d’un échec de la politique menée par la France. Le retrait de la force « Barkhane » du Mali, annoncé en février, et la multiplication de manifestations hostiles à la France et à ses intérêts auront été des éléments marquants de cette réalité. Ils ne sont pas les seuls.
Le conflit sahélien a pris une tournure géopolitique nouvelle que la crise ukrainienne éclaire de façon inattendue avec la consolidation des intérêts russes dans la région. La politique française au Sahel est en cela un chantier de reconstruction majeur qu’il faut aborder avec sérieux et clairvoyance.
Cela implique de tirer les leçons des manquements et des revers de son approche, qui aura été principalement structurée autour d’une dimension militaire et sécuritaire, sans prise en considération suffisante des racines politiques et sociales de la crise. Les gouvernements sahéliens peinent à assurer à l’ensemble de la population – dont 40 % vit sous le seuil de pauvreté – les services sociaux de base tels que la santé, l’éducation, la protection sociale, la sécurité, et le respect des droits fondamentaux.
Le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, trois des cinq pays du G5 Sahel, sont désormais gouvernés par des autorités militaires ; 4,5 millions de personnes ont fui les violences et près de 7 millions de personnes au Sahel central sont en insécurité alimentaire aiguë.
Basculement
Cette crise multidimensionnelle conduira sûrement les populations sahéliennes à opérer de nouveaux choix de formes d’Etat et plus largement de valeurs et modèles de société. Comme en témoignent l’extension des conflits, les contestations populaires et l’instabilité politique, la région est sans doute en train de basculer dans une nouvelle période de son histoire.
Les forces vives des sociétés civiles françaises et sahéliennes n’ont cessé d’alerter sur la réduction de l’espace civique et des libertés fondamentales, la mauvaise gestion et le détournement des fonds publics, ainsi que l’impunité. Mais la France n’a pas su se mettre à leur écoute. Et elle a trop rarement mis les questions de gouvernance, de droits humains, de transparence et de redevabilité au cœur du dialogue politique qu’elle entretient avec les pays de la région.
Les prises de position contradictoires du président français face aux ruptures constitutionnelles au Tchad et au Mali au printemps 2021 ont aussi contribué à éroder la crédibilité de Paris. Ce double standard a généré des questionnements majeurs sur les objectifs de la présence française et les valeurs démocratiques qu’elle prétend porter, dans un contexte de déconnexion croissante avec les sociétés sahéliennes.
Les interventions armées au Sahel n’ont pas su garantir suffisamment la protection des civils, qui, d’année en année, sont plus nombreux à succomber aux violences des groupes dits djihadistes, mais aussi des armées nationales ou des milices d’autodéfense. La France est restée très silencieuse face aux allégations d’exactions de ses armées partenaires au Sahel. Elle ne s’est pas non plus montrée exemplaire, loin s’en faut, quand ses propres forces ont été mises en cause dans la mort de civils. En témoignent les épisodes meurtriers de Bounti (Mali) et Téra (Niger) en 2021, pour lesquels la France n’a pas voulu d’enquêtes indépendantes.
Cette opacité alimente les spéculations et provoque une colère grandissante au sein des populations vis-à-vis de l’armée française, et plus largement envers la présence française : diplomatique, économique, voire civile et humanitaire.
Entre les quatre murs de l’Elysée
Au cours de la dernière décennie, la politique française dans la région a aussi souffert d’un manque de consultation publique en France même. L’évolution des opérations extérieures au Sahel a donné l’impression d’être réglée entre les quatre murs de l’Elysée.
Si, le 22 février, le Parlement français a eu l’occasion de débattre de la situation au Sahel, ce débat s’est tenu quand la décision du retrait militaire du Mali était déjà actée. Force est de constater que, depuis 2013, l’intervention française dans cette région aura été avant tout marquée par la faiblesse du contrôle démocratique.
Nous invitons donc le président de la République, ainsi que les nouveaux parlementaires, à organiser d’ici à la fin de 2022 un grand dialogue national sur les suites de la stratégie française au Sahel et en Afrique. Celui-ci serait l’occasion d’une vaste consultation, reflétant la diversité des expertises liées aux dimensions de la crise et incluant les sociétés civiles françaises comme celles des pays concernés.
Un tel dialogue devrait permettre de définir une nouvelle feuille de route pour refonder l’approche française dans la région. Il s’agit ainsi également d’éviter une rupture durable entre la France et le Sahel, et plus largement avec l’Afrique.
Liste des signataires : Assinamar Ag-Rousmane, directeur des programmes de l’ONG Azhar Mali ; Richard Banégas, professeur de science politique à Sciences Po-CERI ; André Bourgeot, anthropologue et directeur de recherche émérite au CNRS ; Olivier Bruyeron, président de Coordination SUD ; Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente de l’association CCFD-Terre solidaire ; Rémi Carayol, journaliste et coordinateur du comité éditorial d’Afrique XXI ; Emmanuel Charles, coprésident du réseau d’information RITIMO ; Emanuela Croce, codirectrice générale de CARE France ; Adam Dicko, directrice d’AJCAD-Mali ; Nouhoum Diakite, coordinateur de la coalition malienne Publiez ce que vous payez (PCQVP-Mali) ; Laurent Duarte, secrétaire exécutif de Tournons la page ; Cécile Dubernet, enseignante-chercheuse à l’Institut catholique de Paris ; Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France ; Cheikh Fall, président d’AfricTivistes ; Vincent Foucher, chargé de recherche au laboratoire Les Afriques dans le monde du Centre national de la recherche scientifique ; Stéphanie Hartmann, journaliste ; Ali Idrissa, coordinateur national du Réseau des organisations pour la transparence et l’analyse budgétaire (ROTAB) ; Famory Jean Kamissoko, secrétaire exécutif de STOP-SAHEL ; Aminou Laouali, coordonnateur national de SOS-Civisme Niger ; Beatriz de Leon Cobo, coordinatrice du Groupe d’experts du Forum de dialogue Sahel-Europe de l’Université Francisco de Vitoria (Espagne) ; Géraud Magrin, professeur de géographie à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne ; Alexandre Morel, codirecteur général de CARE France ; Roland Nivet, porte-parole du Mouvement de la paix ; Joaquim Nogueira, directeur exécutif d’ECPAT France ; Jean-Pierre Olivier de Sardan, anthropologue et directeur de recherche émérite au CNRS ; Adam Oumarou, président du Conseil des Nigériens de France (CONiF) ; Marc-Antoine Pérouse de Montclos, directeur de recherche àl’Institut de recherche pour le développement (IRD) ; Serge Perrin, animateur du réseau international Mouvement pour une alternative non-violente ; Michel Roy, secrétaire général de Justice et Paix France ; Binta Sidibé-Gascon, vice-présidente de l’Observatoire Kisal ; Alioune Tine, président et fondateur d’Afrikajom Center ; Maïkoul Zodi, coordinateur national de la fédération d’associations Tournons la page, Niger.
Collectif
Le Monde du 7 juillet 2022