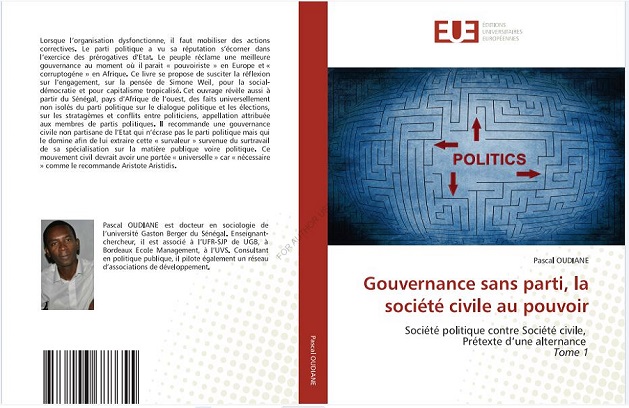Edité par les éditions universitaires européennes, le livre « Gouvernance sans parti la société civile au pouvoir. Société politique contre société civile : prétexte d’une alternance. ».est traduit en six langues ( française, anglaise, italienne, portugaise, espagnole et allemande).
Notes De Lecture
Sur la 4e de couverture la lecture donne une ergonomie très facile sur les différents aspects évoqués dans cet ouvrage.
« Lorsque l’organisation dysfonctionne, il faut mobiliser des actions correctives. Le parti politique a vu sa réputation s’écorner dans l’exercice des prérogatives d’Etat. Le peuple réclame une meilleure gouvernance au moment où il parait « pouvoiriste » en Europe et « corruptogéne » en Afrique.
Ce livre se propose de susciter la réflexion sur l’engagement, sur la pensée de Simone Weil, pour la social-démocratie et pour capitalisme tropicalisé. Cet ouvrage révèle aussi à partir du Sénégal, pays d’Afrique de l’ouest, des faits universellement non isolés du parti politique sur le dialogue politique et les élections, sur les stratagèmes et conflits entre politiciens, appellation attribuée aux membres de partis politiques. Il recommande une gouvernance civile non partisane de l’Etat qui n’écrase pas le parti politique mais qui le domine afin de lui extraire cette « survaleur » survenue du surtravail de sa spécialisation sur la matière publique voire politique. Ce mouvement civil devrait avoir une portée « universelle » car « nécessaire » comme le recommande Aristote Aristidis. »
A propos de quelques premières considérations.
« L’œuvre du sociologue n’est pas celle de l’homme d’Etat » écrivait Durkheim (1871)[1]. « Les sociologues n’ont pas à laisser les contingences du contexte décider du sens politique de leur travail. Il leur appartient de plein droit de statuer souverainement sur la signification à lui donner et sur l’emploi qu’il convient d’en faire » (Wright, 1983 :181)[2]
(…) encadrer in finénotre action dans un esprit purement aristotélicien c’est-à-dire faire acte parce que c’est nécessaire (p.3). (…)
L’opinion publique doit distinguer l’agitateur d’idées du porteur de projet. . Nous sommes porteurs de projet.(…)Le jeu politique avec toute la couleur passionnelle qu’on lui connait reste de la diversion pour le développement des pays africains. Pour ces pays – à quelque exception près – la seule alternative à l’échec du pouvoir politique dirigé par le parti politique c’est le pouvoir militaire avec la coercition des forces armées. Le concert des pouvoirs ne se résume pas à une dyade entre le parti ou l’association politique et les armées mais à une tryade composée de partis politiques, des armées et des associations civiles.Le sociologue ivoirien affirme en toute objectivité que « la colère est le sentiment le mieux partagé chez les africains et surtout chez les jeunes animés de passion pour se libérer de la précarité (…) les africains subissent l’Europe…. » (p.4)mais il conclut avec une déclaration importante qui soutient que cette colère historiquement justifiée s’explique en définitive par « un déficit dans la participation des pays africains au système de mondialisation. » (p.5). En effet, il s’agit du système monde.
L’Afrique veut contribuer à la marche du monde. Elle doit être reconnue dans sa contribution à l’universel. Le discours de Dakar du président français Nicolas Sarkozy à l’époque en exercice– reprochant à l’Afrique de n’être pas suffisamment entrée dans l’histoire- nous est encore resté à la gorge. Le continent dispose d’un capital opérationnel pour sa participation au système monde. Hormis le potentiel naturel, il y a un potentiel humain. L’Afrique cherche plus à exiger une contribution par des idées que par ses avantages naturels savamment pillés par ses partenaires internationaux. Nous ne sommes pas obligés d’être dans l’importation du prêt à penser. Nous devons tropicaliser nos emprunts, produire nos savoirs et garder l’esprit aristotélicien c’est-à-dire faire des choix utiles qui ont le sens de l’universel. Voilà ce qui justifie en partie ce livre intitulé « Gouvernance sans parti la société civile au pouvoir. Société politique contre société civile : prétexte d’une alternance. ». Ce livre porte un modèle alternatif qui met à l’épreuve le parti politique.
« L’espace politique est la chasse gardée des partis politiques qui se disputent l’exercice du pouvoir d’Etat. Ces partis politiques sont les vecteurs de l’idéologie de gouvernance des différents imaginaires politiques du monde qui s’opposent. Au moment où ces organisations politiques se succèdent au pouvoir, l’Afrique n’a toujours pas connu le développement tant chanté au lendemain des indépendances. De nos jours, même dans les économies avancées, les partis politiques sont de plus en plus rejetés, n’attirent plus l’électorat et ne gagent plus des élections. Pourquoi l’Afrique de même que les autres économies en retard persisteraient-elles dans ce sens qui responsabilise exclusivement aux affaires politiques les partis politiques ? Pourquoi la société civile doit –elle se cantonner à jouer les seconds rôles ? Aux partis politiques, il est octroyé le rôle d’opposition au pouvoir en place. Pourquoi la société encore une fois est instrumentalisée pour massifier les manifestations populaires ? La société civile, c’est le peuple. Elle se fonde sur des critères associatifs pour regrouper des intérêts qui partagent et cherchent les mêmes voies d’accomplissement. A côté des associations politiques, nous pouvons compter au sein du peuple, entre autres, des associations de développement, des associations sportives, des associations culturelles, des associations économiques, des associations religieuses, des associations syndicales. » (p.6).
- L’intérêt national doit être porté par et sur des idées, moins sur des personnes (p.8)
Il est une question centrale, c’est celle-ci : pourquoi une personne ne serait-elle pas compétente et pourquoi le serait une autre et non elle ? D’abord, l’expérience exigée à la qualification. Ensuite, l’expérience handicapée par l’âge, Enfin, l’expérience ne conditionne pas le service.
Suite Notes De Lecture du Livre de Pascal Oudiane (2023 Partie 1 : Le Pretexte D’une Alternance Civile A La Gouvernance De L’etat (p.17)
- La Gouvernance hors parti politique (p.19)
La gouvernance hors partis politiques : La naissance d’une volonté de GSP est l’héritier logique du post modernisme dans lequel nous assistons à un « Désengagement des citoyens vis-à-vis de la vie démocratique du fait de l’affaiblissement de la crédibilité des institutions démocratiques associées à l’Etat-nation (parlements, partis, syndicats » (p.20).
- Simone Weil pour la suppression des partis politiques (p.22-31)
Entre les années 1940 et 1950 Simone Weil, une philosophe française née en 1909, écrit et plaide pour la suppression des partis car ils sont porteurs du germe du totalitarisme. Les partis politiques imposent l’homogénéité en leur sein. Deux conséquences en découlent selon Simone Weil : une trahison possible contre le parti ou une trahison contre la pensée critique du militant lui-même. Autrement dit, le choix du militant devra porter sur « la fidélité au parti ou l’infidélité à sa pensée. » (p.24) voire l’inverse. A défaut d’accepter la contradiction, il apparait comme un prétexte de la socialisation à la trahison.
Les partis sont intrinsèquement liés par une finalité qui est de se porter et de resterau pouvoir. Nous sommes d’accord avec la pensée de Simone Weil qui stipule que le « but du parti politique n’est plus d’instaurer le bien commun (…) mais de continuer à croître indéfiniment. » Le parti malgré ses mensonges il continu a incarner le bien. Le bien ce n’est pas le pouvoir d’après Simone Weil, c’est la vérité. Le parti s’en écarte très souvent. C’est le bien commun, la volonté générale, la démocratie, voilà ce qui doit gouverner.
La démocratie, ce n’est pas le pouvoir du peuple, c’est le pouvoir de la raison du peuple. La raison unit car elle est universelle tandis que les passions sont individuelles et susceptibles de diviser.La démocratie n’est pas une question passionnelle. Un peuple sous l’emprise de la passion collective ne peut être stable.
- La pertinence de la gouvernance civile en alternative à la gouvernance politiquement clientéliste (p.31-62)
Il est préférable de gouverner hors des partis politiques pour treize raisons dont le fonctionnement du parti provoque la pertinence.
- Cause1 : La politique est un instrument prématuré pour les économies en retard.
- Cause2: L’apologie de la transhumance ou une autre forme de recrutement politique
- Cause3 : Les promesses électorales sur le mandat présidentiel
- Cause 4 : Les corollaires du pouvoir ou les risques de l’embourgeoisement issu de la pratique du pouvoir
- Cause 5 : La rationalité du parti politique : finalité et objectivité.
- Cause 6 : La formation idéologique en perte de vitesse dans la priorité du parti politique.
- Cause 7 : La professionnalisation de l’engagement politique
- Cause 8 : La compétence des acteurs politiques
- Cause 9 : Une carrière politique bien remplie est l’équivalent d’une existence monarchique
- Cause 10 :L’homme d’Etat, l’arnaque des politiques.
- Cause 11 : Crise dans les partis politiques : les conséquences de l’absence de démocratie et de l`échec électoral
- Cause 12 : Les gouvernements politiques : le véhicule des lourdeurs au développement économique et social.
- Cause 13 : Les partis politiques n’attirent plus et ne gagnent plus
Il est pertinent à la suite de ce chapelet de prétexte de manœuvrer pour la survenue d’une alternance civile tenue par une association non politique ou une personnalité civile non issue d’un parti politique.
Pour opérationnaliser la gouvernance civile, la social-démocratie sera au cœur de ce paradigme.
– La social-démocratie(Chap.2, de l’idéologie de gouvernance civile, p.63-87.)
Celle-ci est un impératif pour l’Afrique et le Sénégal. Le pays a besoin de réforme pour mieux partager les ressources et essaimer la démocratie, réglementer les marchés et de mettre en place de bonnes politiques de planification. En renforçant la démocratie parlementaire la social-démocratie nous permet de renforcer la démocratie sociale.
« L’idée, en matière économique, est d’éviter ou atténuer les effets négatifs du libéralisme « sauvage », par une action de l’Etat sur la production et les marchés, visant la satisfaction de la demande en biens de consommation et services essentiels, à la stabilité des prix et de la monnaie et au plein emploi. Les moyens employés consistent principalement, en une réglementation, des interventions ou incitations financières et, le cas échéant, la création ou le maintien d’un secteur public, à côté du secteur privé, largement majoritaire, de la libre entreprise (…). Au plan social et humain, il s’agit d’atténuer les inégalités en développant le niveau d’éducation, les équipements et services publics, la protection sociale, sanitaire, etc… » (p.64).
Dans le cadre politique la social-démocratie reconnait qu’il y a des intérêts qui s’affrontent et propose la négociation et le compromis pour la résolution des conflits. Tout en cautionnant le pluralisme la social-démocratie recommande la modération et la mise en place d’organisation dédiée la négociation et la concertation.
Par contre, il existe des limites à la social-démocratie qu’il faudra juguler notamment la forte présence de l’Etat dans le marché et les difficultés d’endiguer la mondialisation du libéralisme économique. L’Afrique y compris le Sénégal souffre énormément de ces deux choses. Il faut donc corriger. L’alternative au capitalisme libéral passera plus par une innovation que par la modernisation qui s’oriente plus vers le rationalisme instrumental et le calcul. Essayons le libéralisme solidaire qui parfois peut être un capitalisme communautarisant utile.
- Notre innovation dans la social-démocratie (p.71-87.
Le contexte justificatif de la modélisation de l’innovation sociale par d’un problème majeur : l’élite. Comment la rapprocher des intérêts des plus démunis en capital ? Comment faire pour créer moins de pauvres ?
Pour trouver une formule de réduction de la masse de pauvres, il ne s’agit pas de sacquer le libéralisme vu le rôle que peut jouer une élite économique au sein d’un pays mais de l’humaniser au mieux contre son procès chosifiant et accumulateur excessif en outrance. Le projet de modélisation doit déboucher sur une efficacité de l’articulation entre capitalisme et institutions de tradition africaine et interroger les causes des crises économiques… (p.71). nous avons que la crise n’est plus seulement industrielle avec le rapport capital/travail mais elle est dans les sphères de circulation (créancières voire financières). (p.75)
Il faut se baser techniquement sur les institutions sociales (la famille, l’ethnie, la religion, l’entreprise, la citoyenneté, la nation) et la pénurie structurelle pour insuffler une nouvelle dynamique à l’état systémique actuel de nos Etats (…) Le concept de capitalisme communautarisant est ce qui manquait au capitalisme solidaire parce qu’il lui donne forme et lui permet de prospérer. La formalisation de la solidarité reviendrait à la communautarisation du capital sous le rapport des similarités sociales (p.73).
Il faudra instituer non pas un libéralisme social mais un libéralisme solidaire. Ce qui voudra dire que la social-démocratie se verra ajuster non pas exclusivement vers les libertés quantifiées au pluralisme mais vers des libertés solidaires donc des libertés qualitatives à l’aune de la reproduction de l’inclusivité des richesses qui sont réalisées.
Le libéralisme solidaire est un conducteur de contrôle d’efficacité du libéralisme social car capable d’enfermer les libertés dans un système de solidarité productif et inclusif.
Par ailleurs aussi il faut une moralité dans l’échange. Il faut comme le préconise E. Durkheim une régulation sociale qui s’occupe non pas de poursuivre les fraudeurs au nom d’une institution qui ne joue plus son rôle mais de rééquilibrer les rapports sociaux déjà intenses. Ce qui veut dire que c’est moins l’affaire du juridique que celle du politique dont l’activité peut impacter les institutions.
- Le capitalisme repensé à partir du relationnel
L’objectif dans le nouveau capitalisme que nous proposons devrait être de libérer l’acteur économique de l’emprise de la pénurie non pas en l’isolant par l’accès à un capital monétaire mais en l’intégrant dans le social par l’arbitrage légal des intérêts ou besoins (des ressources, des investissements, des revenus).
L’instrument à mobiliser pour atteindre cette finalité ne doit pas être monétaire. (…) Il ne faut pas s’isoler des autres. Tout au contraire, il faut aller vers eux et profiter du relationnel qui existe en fait et que nie à tort malheureusement la pensée néoclassique.
Nous ne sommes pas pour des salaires faibles nonobstant des services publics de qualité. Il faut ainsi avec l’existence du surplus monétaire contraindre les gens à l’investissement.
Le relationnel est un vecteur de création de richesse. Il incarne la mise en commun des intérêts particuliers. Rappelons au passage que le social est l’espace relationnel considéré comme une méthode d’agir sur la société qui est une formation systémique des interactions mutuellement acceptées et vécues par des individus.
- Société civile : la société civile se définit en dehors de l’Etat(société civile : sociétascivilis p.89-127)
La société civile, c’est le peuple. Elle se fonde sur des critères associatifs pour regrouper des intérêts qui partagent et cherchent les mêmes voies d’accomplissement. A côté des associations politiques, nous pouvons compter, entre autres, des associations de développement, des associations sportives, des associations culturelles, des associations économiques, des associations religieuses, des associations syndicales.
Ralf Dahrendorf (1990) considère que : « la société civile concerne les sources de pouvoir significatives en dehors de l’État… » Elle n’est pas forcément opposée à l’Etat contrairement à beaucoup de perceptions. Nous ne sommes pas d’accord avec ce point de vue sur le statut d’opposition car elle n’est pas une réalité absolue. La société civile est certes distincte de l’Etat mais ne lui est pas forcément opposée au-delà du fait que celui-ci porte la capacité de la contrôler.
Elle est créateur de lien (économique, culturel, religieuse, etc..) en dehors du cadre et de l’intervention de l’Etat. Elle justifie son activité par l’organisation de la vie sociale « selon sa propre logique, notamment associative, qui assurerait la dynamique économique, culturelle et politique » (Jean Louis Quermonne).
Pour les nations unies « la société civile est le « troisième secteur » de la société, aux côtés du gouvernement et du monde des affaires.
L’un des plus grands sociologues français du XXe siècle Pierre Bourdieu (1930- 2002) désigne la société civile par ce qu’il appelle « le cercle de la reproduction de l’ordre social ».
Pour un philosophe « les composants sémantiques de la notion de société civile sont rebelles à tout exercice de conceptualisation. Au même titre que les notions de peuple et de nation, » ( P.Ghils, 1986 : 129).
Le philosophe marxiste italien Antonio Gramsci, qui pense la société civile comme une instance conflictuelle entre les classes sociales. Alexis De Tocqueville (1835) qui pense la société civile comme une instance de pacification et d’intégration conditionnée par son orientation collective qui privilégie la solidarité puis par son orientation civile qui évoque l’émancipation de la tutelle de l’Etat et privilégie également des valeurs affectives et de familiarité.
Pour certains, il s’agit de « corps intermédiaires » qui régulent le lien entre l’Etat et les citoyens c’est-à-dire un « ensemble d’associations volontaires, de formes publiques d’expression indépendante, de réseaux qui nourrissent le lien social entre les individus, puis entre eux et les institutions sociales sur lesquelles l’État n’intervient pas directement. »
Une équipe de recherche de l’université de Sherbrooke au Canada a désigné la société comme un « large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui groupe qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres. Il s’agit de groupements communautaires, organisations non gouvernementales (ONG), syndicats, organisations de populations autochtones, organisations caritatives, groupements d’obédience religieuse, associations professionnelles et fondations privées.»
Dans le modèle français, la société civile dépend du fonctionnement de l’Etat. Elle est moins autonome que le modèle britannique dans lequel « l’Etat y apparaît plus comme un « centre de coordination » qu’en tant qu’espace propre.
Son renforcement est la condition et la garantie d’un régime démocratique. Le cas du Mali est édifiant à ce propos. Par contre, la société civile peut être source de tension dans sa coloration religieuse comme le cas de la Tunisie avec le mouvement islamique devenu parti politique Ennahda. Auparavant ailleurs notamment en Algérie le FIS est reconnu par le gouvernement comme un parti politique.
- La question du développement en Afrique
La question du développement a été aussi une opportunité d’expression pour la société civile.
« Dans les années 80, on voit apparaître les prémices d’un nouvel intérêt pour d’autres forces sociales, d’autres acteurs du développement. Dans le champ académique pour le courant post-développementaliste (…), la politique ne se réduit plus uniquement à l’État (…) et il convient à présent d’être attentif aux modes populaires d’action politique. » (Gautier Pirotte, 2007 : 69).
Cette pensée conforte notre conviction selon laquelle la société civile peut poser des actions politiques. La démocratisation repose sur les échanges entre l’Etat et une société civile institutionnalisée, différenciée et complémentaire ( R.Otayek 2002)
« En Afrique, ce sont les bailleurs de fonds qui ont reconstitué la société civile en montrant que l’État est incapable de réaliser une bonne gouvernance. » Ces financements bilatéraux ou multilatéraux ont entrainé « complexe développeur international » selon Gautier Pirotte.
Pour l’historien sénégalais Mamadou Diouf « la notion de société civile peut-elle capturer toutes les actions présentes dans l’espace politique et économique africain ? ». (…) V. Nzambazamariya, professeur à l’université de Kigali, affirme que « le Rwanda est une expérience d’une société civile qui a organisé le massacre (André Guichaoua, 2010). »
- La pertinence de l’alternance vers la société civile.
Nous n’allons pas proposer le “consensus” car il se construit. Nous allons construire la trajectoire civile en respectant les diversités. La société civile est une école de la démocratie mais aussi de la solidarité.
[1]Emile Durkheim. (1871). De la division du travail social. Sixième édition. – Paris, Librairie Félix
Alcan, 1932. xiv, 416 p.
[2]Wright., (1983). L’imagination sociologique. La découverte (ed. 1997).
Biographie
Pascal Oudiane est docteur en sociologie de l’université Gaston Berger de Saint- Louis au Sénégal. Il enseigne la sociologie générale à l’UFR -SJP de l’UGB. Il enseigne aussi les organisations, le management et la méthodologie à Bordeaux Ecole management (BEM). Ses enseignements s’étendent à la section de sociologie de l’UVS du Sénégal pour le panafricanisme, l’économie et l’intégration sous-régionale en enfin l’Afrique dans la mondialisation. Pascal OUDIANE est consultant en politique publique. Il travaille également dans les instances associatives de développement et se réclame de la société civile. Fondateur de l’association Socialinnov et membre de plateforme citoyenne, membre fondateur de l’association Sénégal Ca Kaw ca Kanam, le sociologue lance le projet GSP (Gouvernance Sans parti) qui porte le programme PRASEM (pôle régionaux à vocation sociale, économique et de mobilisation politique).