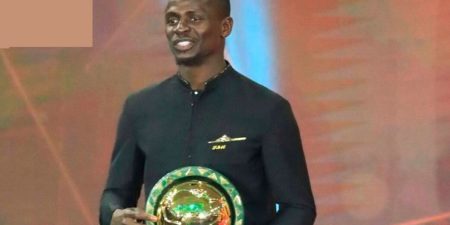En avril 2024, le ministère du Commerce lançait un programme novateur : le recrutement de 1000 volontaires du commerce pour appuyer les services déconcentrés dans la régulation du marché intérieur et la protection des consommateurs.
Un an plus tard, ces jeunes, sélectionnés avec rigueur et enthousiasme, attendent toujours leur formation, leur affectation et leur prise de service. Cette attente prolongée alimente une inquiétude légitime : sans suite rapide, c’est la crédibilité du dispositif et au-delà, celle de l’État qui risque d’être compromise.
Un enjeu de confiance et de souveraineté
La régulation du marché n’est pas un simple exercice administratif ; elle constitue un levier essentiel de souveraineté économique et de justice sociale. Dans un contexte marqué par la vie chère et les pratiques spéculatives, l’État doit démontrer sa capacité à protéger les ménages, encadrer les acteurs économiques et garantir la loyauté des échanges.
Les 1000 volontaires du commerce représentent un maillon essentiel de cette régulation. Leur déploiement permettra de renforcer la présence de l’État sur le terrain, de moderniser les pratiques de contrôle et de restaurer la confiance des citoyens dans l’action publique.
La nécessité d’une territorialisation du contrôle
Le succès de ce programme repose sur une approche claire : la territorialisation.
Chaque région dispose de ses propres réalités économiques : zones agricoles, marchés hebdomadaires, circuits industriels, zones frontalières. Ces spécificités appellent des réponses adaptées.
Ainsi, les volontaires doivent être répartis régionalement, intégrés aux inspections régionales du commerce et encadrés par des structures locales. Ce maillage effectif est la condition pour assurer proximité, efficacité et visibilité de l’action publique.
Une gestion externalisée pour plus d’efficacité
Pour garantir transparence et performance, la gestion opérationnelle du programme gagnerait à être externalisée à des opérateurs privés spécialisés, sur une base régionale.
Cette démarche permettrait :
Une meilleure efficacité : un opérateur par région, chargé de la formation, du suivi et du reporting.
Un suivi en temps réel : grâce à une plateforme numérique mutualisée intégrant les données régionales dans une base nationale.
Une responsabilisation accrue : des objectifs clairs, mesurables et évalués régulièrement.
Un allègement administratif : les services du ministère resteraient stratégiques et superviseurs, sans être absorbés par la logistique.
Les volontaires bénéficieraient ainsi de modules de formation homogènes, de chartes d’éthique, d’un encadrement structuré et d’une valorisation à travers indemnités, attestations de service et perspectives de carrière.
Une opportunité à saisir
Ce programme n’est pas seulement une réponse conjoncturelle à la vie chère : il est une opportunité de long terme pour :
Renforcer la régulation du marché intérieur ;
Structurer le volontariat national comme vivier de compétences civiques et professionnelles ;
Restaurer la crédibilité de l’État en tenant parole et en mettant en action une jeunesse prête à s’engager.
Mais le temps presse. Chaque mois perdu accroît le risque de démobilisation des volontaires et d’incompréhension des citoyens.
De l’annonce à l’action
Le programme des 1000 volontaires du commerce ne doit pas rester une promesse. Il doit devenir une réalité tangible, visible et efficace. Sa mise en œuvre, territorialisée et adossée à une gestion externalisée par région, offrira au ministère une visibilité accrue, aux jeunes un espace d’engagement valorisé, et aux consommateurs une protection renforcée.
En honorant rapidement cet engagement, l’État enverra un message fort : la parole publique engage, et le commerce, en tant que pilier de la vie nationale, mérite une régulation crédible, moderne et proche des citoyens.
Par Souleymane Jules Sène