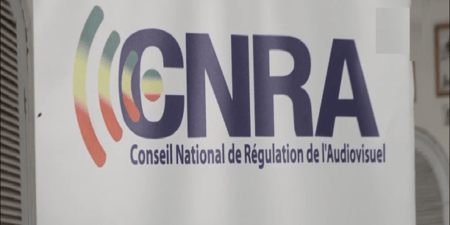Président de la Commission de la CEDEAO, S.E. Dr Omar Alieu Touray a reçu officiellement, ce mardi 4 février 2024, à Abuja, au Nigeria, la première édition des Perspectives Économiques Régionales de la CEDEAO (PERC). Cette édition est placée sous le thème « Revue Prospective des Dynamiques Économiques Régionales face aux risques d’Instabilité Politique et aux Menaces Sécuritaires », analyse des défis et opportunités économiques actuels des États membres de la CEDEAO.
En synthèse, ce rapport examine l’importance de la paix et de la stabilité comme moteurs du développement, conformément à la Vision 2050 de la CEDEAO pour une région prospère et pacifique.
Il a identifié un retard de l’organisation dans l’atteinte de l’ODD 16 (Paix, Justice et Institutions fortes) d’ici 2030, avec des progrès mitigés. Une analyse SWOT (SWOT: strengths, weaknesses, opportunities, and threats), outil qui permet d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui d’une organisation ou d‘un projet, recommande une réforme du Protocole additionnel sur la Démocratie et la Gouvernance, une collaboration renforcée avec l’Union africaine et l’ONU, et la mobilisation de ressources pour sa Force en Attente.
La revue conclut que l’environnement mondial impacte les perspectives économiques de la région et souligne la nécessité de réduire les disparités économiques par la diversification et le développement du capital humain. Des recommandations stratégiques incluent la coordination de politiques macroéconomiques pour un développement harmonieux, l’intégration financière régionale et une réforme de l’architecture sécuritaire. Ces actions visent à renforcer la sécurité et à concrétiser le Pilier 1 de la Vision 2050 de la CEDEAO.
Dans ce cette édition 2023, le chapitre initial aborde le ralentissement économique mondial causé par la pandémie de COVID-19 et le conflit Russie-Ukraine, entraînant une inflation élevée et une contraction de la croissance mondiale à 1,7 % en 2023. La région CEDEAO a résisté avec une croissance modérée de 3,9 % en 2023. Cependant, les pressions inflationnistes globales ont affecté la zone, notamment dans les pays à faible revenu, où les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont fortement augmenté.
Le Chapitre 2 du rapport se concentre sur les performances et les perspectives économiques de la CEDEAO de 2010 à 2022. Les économies des États membres ont été marquées par une croissance fluctuante, impactée par des crises sanitaires comme Ebola et la pandémie de COVID-19, ainsi que par des chocs économiques tels que la chute des prix du pétrole. Après une croissance de 5,2 % en 2011, le taux est tombé à -0,6 % en 2016, avant de remonter légèrement à 3,9 % en 2022, indiquant une reprise post-COVID-19.
Pendant cette période, l’inflation est restée élevée, atteignant 17,3 % en 2022 en raison de la dépréciation des monnaies nationales, de la hausse des prix alimentaires et de la persistance des effets de la COVID-19. Les finances publiques de la CEDEAO ont également été mises à l’épreuve avec un déficit budgétaire régional passant de -4,5 % en 2010 à -5,6 % en 2022. Cette augmentation est liée au poids du service de la dette et aux dépenses supplémentaires pour faire face à la COVID-19.
En matière de perspectives, le PIB régional est attendu à 4,1 % en 2024, soutenu par la croissance de certains pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal). Cependant, les risques liés à l’instabilité politique dans plusieurs pays, les coups d’État et les sanctions pourraient affecter cette prévision.
L’inflation devrait diminuer graduellement, passant de 18,8 % en 2023 à 11,9 % en 2025, même si certains États, comme le Ghana, devraient continuer à enregistrer une forte inflation.
Les tensions géopolitiques mondiales, notamment le conflit Russie-Ukraine, pourraient intensifier les pressions inflationnistes en augmentant les prix de l’énergie et des produits alimentaires.
En outre, la vulnérabilité climatique dans la région pourrait aggraver l’extrême pauvreté, ajoutant aux défis sociaux et économiques.
Les projections de croissance restent inégales selon les pays, avec des taux élevés dans la zone UEMOA et des difficultés dans la ZMAO, particulièrement pour le Nigeria et le Ghana, confrontés à des politiques monétaires restrictives et à des défis énergétiques. La diversification économique, notamment dans l’agriculture et les infrastructures, pourrait aider à stabiliser les prix des matières premières à long terme, tout en favorisant la résilience face aux chocs externes.
Le Chapitre 3 du rapport aborde les défis de paix, de sécurité et de stabilité, éléments clés pour le développement socio-économique de la région, alignés sur le Pilier 1 de la Vision 2050 intitulé
« Paix, Sécurité et Stabilité ». Bien que la paix et la sécurité soient un objectif stratégique, la CEDEAO fait face à des difficultés croissantes en raison de conflits et de coups d’État récurrents, notamment depuis 2021 au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Cette instabilité politique reflète des lacunes démocratiques préoccupantes et augmente les menaces sécuritaires.
L’insécurité maritime dans le Golfe de Guinée, marquée par la piraterie, coûte annuellement près de 1,94 milliard de dollars aux États concernés, compromettant leur développement économique.
L’indice moyen de paix dans la région s’est dégradé en 2022, atteignant 2,25 contre 2,20 en 2021, avec des disparités significatives : alors que la Gambie, le Ghana et la Sierra Leone sont relativement stables, le Burkina Faso, le Mali, le Nigéria et le Niger demeurent vulnérables face au terrorisme et aux violences civiles. L’insécurité sévit surtout dans le Sahel, mais les États côtiers (Côte d’Ivoire, Togo, Bénin) sont également menacés dans leurs zones frontalières.
Cette insécurité a entraîné des déplacements massifs, affectant plus de six millions de personnes dans la région en 2022, dont une majorité de déplacés internes. La situation découle de facteurs complexes tels que la mauvaise gouvernance, les tensions communautaires, la démographie, le chômage des jeunes et les menaces environnementales. Ces crises sécuritaires perturbent les secteurs de l’éducation et de la santé, forçant des fermetures massives d’écoles et de centres de santé, surtout au Burkina Faso, au Mali et au Niger.