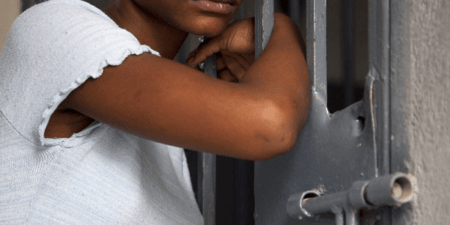Le système éducatif public sénégalais traverse une crise multidimensionnelle. Les symptômes en sont visibles et alarmants : grèves récurrentes, un déficit de plus de 6 500 enseignants, des classes surchargées et des résultats aux examens nationaux en deçà des attentes. Plus grave encore, plus de 1,5 million d’enfants sont exclus du système scolaire. Cette situation érode la confiance des familles et alimente l’expansion d’un secteur privé parfois perçu comme un simple « business » éducatif. Comme le soulignait Cheikh Anta Diop, « Un peuple qui n’éduque pas sa jeunesse se condamne à la dépendance. »
Dès lors, il est impératif d’analyser les défis structurels pour construire une école ancrée dans nos réalités et tournée vers nos besoins.
L’école : un moteur de progrès déficient
Il faut le reconnaître, l’école sénégalaise vit une crise identitaire et existentielle profonde, héritée d’un modèle colonial qui a creusé un fossé entre l’institution scolaire et la société. On observe ainsi un curriculum encore trop centré sur des références exogènes, qui marginalise l’histoire, les modèles moraux et les figures emblématiques sénégalaises. Cette déconnexion a un impact négatif immédiat : moins de 10 % des jeunes de 15 ans atteignent le niveau minimal en lecture, mathématiques et sciences. Pire, elle engendre un chômage endémique des diplômés, frôlant les 26 %, signe d’une inadéquation criante entre la formation et les besoins de l’économie.
Face à cette réalité préoccupante, il est urgent de repenser l’école sénégalaise comme un moteur de compétences, de citoyenneté et de solidarité. L’éducation doit éveiller la conscience critique et préparer les jeunes à transformer leur société. Paulo Freire l’affirmait : « L’école ne peut se limiter à transférer des connaissances ; elle doit éveiller la conscience critique et libérer l’individu pour qu’il transforme la société. »
Hannah Arendt abonde dans le même sens en soulignant que l’école, plus qu’une institution de transmission de connaissances ou un « appareil idéologique » de l’État, doit avant tout remplir sa noble mission d’ouvrir l’univers intellectuel des citoyens, gage d’une créativité salutaire pour la communauté. Aussi disait-elle : « Le rôle de l’école est d’apprendre aux enfants ce qu’est le monde, et non pas leur inculquer l’art de vivre. » Le Sénégal peut s’inspirer de modèles internationaux comme ceux de la Finlande, du Japon ou de la Corée du Sud, qui ont fait de l’éducation le pilier de leur essor.
Les piliers d’une réforme ambitieuse et souveraine
Pour bâtir une école adaptée aux défis du XXIe siècle, une réforme courageuse doit s’articuler autour de plusieurs axes :
La souveraineté curriculaire et linguistique doit être au cœur de toute politique éducative digne de ce nom. Il s’agit de réconcilier notre école avec nos valeurs et nos principes, tout en l’enrichissant d’idéaux universels tels que l’humanisme et la démocratie. Le curriculum doit intégrer l’histoire, l’écologie et les savoirs endogènes sénégalais.
La promotion des langues nationales dans l’apprentissage fondamental est cruciale pour former des citoyens décomplexés et fiers de leur identité culturelle, dans un monde où les sources d’aliénation restent vivaces.
La pédagogie de la compétence et de l’action nécessite de rompre avec l’approche purement théorique. Valoriser les filières techniques, scientifiques et le numérique est impératif pour répondre aux défis économiques et à la révolution digitale, créatrice d’emplois. Cela passe par une révision des programmes et un apprentissage par l’action.
La valorisation et la formation des enseignants sont incontournables. Aucune réforme ne peut aboutir sans les femmes et les hommes qui l’incarnent. Investir dans une formation initiale et continue de qualité, notamment sur les nouvelles pédagogies et l’utilisation des langues nationales, est non négociable.
Une école inclusive et protectrice doit être un sanctuaire pour tous les enfants et un levier de promotion sociale, surtout pour les couches les plus vulnérables. Les programmes sociaux, tels que les cantines scolaires, sont essentiels pour lutter contre les discriminations et les violences, et assurer une réelle équité.
Ces réformes impliquent des investissements massifs. Le coût peut sembler élevé pour un État au budget restreint, mais l’inaction est bien plus coûteuse. Comme le rappelait Cheikh Anta Diop, « Enseigner, c’est semer des graines d’humanité. » Tous les pays qui se sont développés, à l’instar du Japon et de la Corée du Sud, ont bâti leur succès en misant sur une éducation de qualité. C’est cette conviction qui inspirait Nelson Mandela lorsqu’il affirmait : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. »
Bâtir l’école du futur : un projet de société
Réformer l’école, ce n’est pas seulement revoir les programmes : c’est refonder un projet de société. Chaque élève doit en sortir avec la capacité de comprendre, d’agir et de transformer son environnement. Investir dans l’éducation, c’est investir dans le progrès social, la souveraineté nationale et la stabilité, en offrant une alternative à la migration clandestine.
Le Sénégal dispose d’une jeunesse talentueuse, intelligente et créative. Ce qui manque, c’est une école qui lui donne un sens, une direction et les outils pour bâtir son avenir. Réformer l’éducation, c’est restaurer la dignité du savoir et, par-delà, la dignité même de la nation. Comme le disait Kofi Annan, « La jeunesse est l’avenir de toute société. Elle a le pouvoir de transformer le monde et de le rendre meilleur. C’est à nous de fournir les moyens nécessaires pour que cette transformation se réalise. »
Ciré Aw