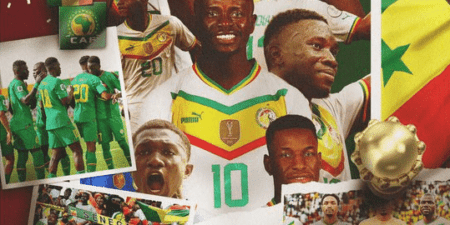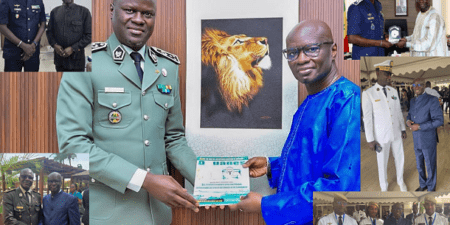Le 13 septembre 1957, Amadou Mahtar Mbow s’illustra comme l’un des pionniers du panafricanisme culturel en créant à Saint-Louis du Sénégal la toute première association africaine dédiée au développement des bibliothèques publiques.
À une époque où les structures éducatives et culturelles restaient encore largement héritées du modèle colonial, il conçut un projet novateur : la mise en place d’un véritable réseau de bibliothèques publiques en Afrique occidentale française. Cette initiative fut présentée non seulement au Haut-Commissaire de l’AOF, mais aussi à l’ensemble des lieutenants-gouverneurs, signe de sa volonté d’inscrire l’action dans une dynamique régionale et intégrée.
Avec les indépendances africaines, dès 1961, l’association poursuivit son plaidoyer, convaincue que l’accès aux livres et au savoir constituait un pilier essentiel de l’émancipation des peuples africains. C’est dans ce cadre qu’elle organisa une rencontre inédite entre responsables africains et scandinaves sur la question des bibliothèques.
Cet événement marqua un tournant : il ouvrit la voie à une coopération internationale débarrassée des logiques coloniales. Le Danemark, sensible à cette démarche, apporta un financement exceptionnel pour la création d’une bibliothèque pilote à Dakar, appelée à devenir un modèle pour le continent.
Mais le projet se heurta rapidement aux réalités politiques. Le président Léopold Sédar Senghor et son gouvernement y virent un risque : celui de renforcer le PRA-Sénégal, le parti d’opposition auquel appartenait Mbow. Craignant que cette initiative ne serve de vitrine à ses adversaires, Senghor bloqua le dossier. Le financement danois fut alors redirigé vers l’université de Makerere, en Ouganda, privant le Sénégal d’une opportunité historique.
Loin de se décourager, Amadou Mahtar Mbow et son association poursuivirent leur œuvre avec ténacité. Ils réussirent à créer une première bibliothèque à Saint-Louis, ensuite transférée à la Médina, à Dakar. Ce lieu ne fut pas seulement un espace de lecture : il devint un centre de formation pour les premiers bibliothécaires africains, contribuant ainsi à jeter les bases d’un véritable corps professionnel dans le domaine.
Ainsi, malgré les résistances politiques, l’initiative de Mbow portait une double ambition : un panafricanisme culturel, visant à unir les peuples autour du savoir et de l’éducation, et une lutte contre la confiscation du savoir par une élite ou par le pouvoir. Sa vision préfigurait une Afrique où la bibliothèque publique devait être à la fois un lieu d’accès à la culture et un instrument d’émancipation collective.
L’histoire conserve pourtant une ironie amère : en l’absence de bibliothèque nationale au Sénégal, les manuscrits de Léopold Sédar Senghor reposent aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France, aux côtés de la bibliothèque d’El Hadji Omar, saisie par Archinard après le sac de Ségou. À l’inverse, la bibliothèque privée de Mbow, fidèle à son idéal de partage et d’accès démocratique au savoir, est désormais ouverte à Diamniadio. Un legs qui perpétue sa vision d’un savoir libéré des frontières et mis au service de tous.
Si un jour le Sénégal se dote enfin d’une bibliothèque nationale, ce serait justice de la nommer Amadou Mahtar Mbow.
Kaaw Paam