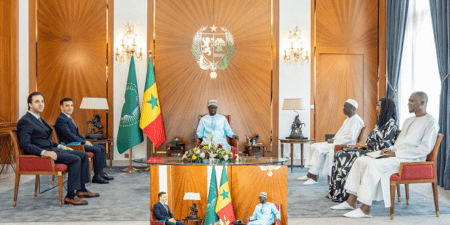Pour combler son déficit budgétaire, l’État sénégalais envisage de taxer les transactions de mobile money. Derrière cet argument de rationalité financière se cache pourtant un risque : fragiliser l’une des plus grandes réussites sociales et numériques du pays.
Mobile money : plus qu’un service, une infrastructure nationale
En dix ans, le mobile money a fait ce que le système bancaire traditionnel n’avait pas réussi en plusieurs décennies : intégrer financièrement la majorité des Sénégalais.
C’est la colonne vertébrale de l’économie informelle. On l’utilise pour envoyer de l’argent, payer des factures, épargner, soutenir le commerce local. Son impact social et économique est massif.
Ce que l’État espère : un gain budgétaire immédiat
L’argumentaire officiel repose sur trois promesses :
• Générer rapidement des recettes pour le budget national.
• Mieux formaliser l’économie.
• Financer la transition numérique, à condition d’une transparence totale sur l’usage des fonds.
Les risques : un pari dangereux déjà perdu ailleurs
Les expériences en Ouganda, au Cameroun et au Ghana sont claires : taxer brutalement le mobile money freine l’usage, accroît l’informalité et rapporte moins que prévu.
Les dangers pour le Sénégal sont multiples :
1. Contraction de l’activité : les coûts plus élevés découragent les transactions. Les usagers retournent au cash et l’État encaisse bien moins que prévu.
2. Injustice sociale : les ménages modestes, les petits commerçants et les agriculteurs seraient les plus touchés, car pour eux, le mobile money est une nécessité, pas un luxe.
3. Coup d’arrêt à l’innovation : la taxe fragiliserait le réseau des agents, bloquerait les fintechs et ralentirait l’interopérabilité régionale, mettant en péril des années de progrès en inclusion financière.
Construire une fiscalité numérique plus juste
Plutôt qu’une taxe punitive, il faut une approche concertée et progressive :
• Pour l’État :
• Exonérer les petites transactions vitales (santé, éducation, transferts de subsistance).
• Plafonner la taxe par transaction et par mois.
• Associer opérateurs, société civile et experts pour co-construire une fiscalité qui préserve l’écosystème.
• Pour les opérateurs :
• Protéger leur réseau d’agents.
• Innover pour absorber une partie de la charge et réduire l’impact pour les usagers.
• Pour la société civile :
• Défendre une fiscalité équitable.
• Exiger de la transparence sur l’usage des recettes générées.
Conclusion : Trouver l’équilibre entre recettes et prospérité
La vraie question n’est pas de savoir si l’État doit lever des impôts, mais comment il peut le faire sans casser un moteur vital du développement.
Une fiscalité mal pensée serait un frein à l’inclusion et à la croissance. Une fiscalité intelligente, progressive et concertée pourrait au contraire consolider les acquis et transformer le numérique en pilier de souveraineté économique.
Marieme Mounira Fofana
Digital Lover