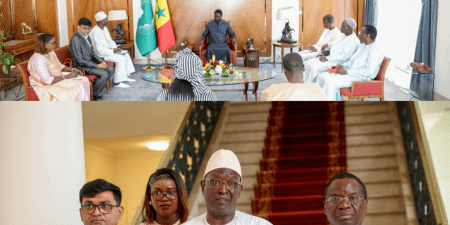La condamnation d’Ousmane Sonko pour diffamation, confirmée par la Cour suprême, semblait clore un contentieux ancien. Mais les déclarations récentes de l’intéressé, invoquant l’existence d’un rapport officiel jusque-là écarté, rouvrent un débat fondamental. Ce débat ne concerne plus seulement une affaire individuelle, mais engage la justice dans ce qu’elle a de plus essentiel : sa capacité à reconnaître l’erreur, et à y remédier.
La décision rendue clôt une séquence judiciaire, mais non une controverse juridique. Car l’enjeu n’est plus simplement de savoir si Ousmane Sonko a franchi les bornes de la critique publique, mais si ce qu’il a dit — et pour quoi il a été condamné — repose ou non sur un fait établi. Le rapport de l’Inspection générale des finances sur le PRODAC, qu’il affirme désormais détenir, soulève une question directe : une déclaration tenue pour diffamatoire peut-elle être requalifiée si les faits qu’elle mentionne se révèlent exacts ?
Aucune demande de révision n’a, à ce jour, été introduite. Mais la perspective l’est. Et si le document évoqué confirme effectivement les propos pour lesquels Sonko a été jugé, la question se posera dans des termes clairs : le droit sénégalais peut-il rester sourd à un élément nouveau qui invaliderait le fondement d’un jugement devenu définitif ?
Ce cas de figure, bien que rare, est prévu par le droit. La procédure de révision, strictement encadrée, existe pour prévenir l’inacceptable : qu’un jugement erroné conserve force de vérité judiciaire, alors même que ses prémisses sont matériellement contestées. Refuser d’envisager cette voie au nom de la stabilité reviendrait à faire primer la forme sur le fond, et l’irréversibilité sur la justice.
Il est reproché à Ousmane Sonko d’avoir publiquement mis en cause certains magistrats après la confirmation de sa condamnation. À ceux qui jugent cette posture indigne de sa fonction, il faut répondre sans détour : la critique d’une décision de justice n’est pas une menace contre l’institution. C’est, au contraire, une exigence dans tout État de droit vivant.
Ceux qui confondent réserve institutionnelle et silence imposé oublient l’essentiel : l’indépendance de la justice ne signifie pas intangibilité de ses actes. Elle protège le juge des pressions, non de l’interpellation argumentée. Elle garantit la liberté de juger, non l’immunité contre la critique. Refuser que certaines décisions soient contestées, c’est sanctuariser la fonction judiciaire au point de la soustraire à la responsabilité.
Sonko n’a pas condamné la justice en bloc. Il a dénoncé des pratiques précises, inscrites dans un contexte politique identifiable, à une période où la justice était régulièrement instrumentalisée à des fins d’élimination. Il n’a pas désigné l’institution, mais certains usages qui l’ont affaiblie. En cela, sa parole n’est pas une attaque : c’est une mise en garde. Et cette mise en garde porte : elle vise à rappeler que lorsque le droit devient un instrument de pouvoir, la confiance s’effrite.
On peut discuter de la forme. Mais on ne saurait occulter le fond. Car ce qui scandalise ici, ce n’est pas la parole du justiciable devenu Premier ministre. C’est la gêne qu’elle provoque dans une institution qui peine encore à se départir de ses zones d’ombre.
Exiger de Sonko qu’il se taise au nom de sa fonction, c’est inverser les principes : ce n’est pas au citoyen de se taire quand l’État dysfonctionne ; c’est à l’institution de se redresser pour ne pas l’y contraindre. Le respect dû à la justice n’est pas un blanc-seing. Il commence par la possibilité de la critiquer sans être disqualifié.
Si ce rapport existe, et s’il avait été écarté au moment du procès, nous serions alors devant un manquement grave au principe du contradictoire. La justice n’a pas seulement pour rôle de trancher ; elle a pour responsabilité de le faire en connaissance de cause. Un procès instruit à charge, dans le silence d’un élément déterminant, n’honore ni le droit ni l’institution qui l’applique.
L’argument de l’amnistie ne saurait suffire à refermer le débat. Elle a suspendu les poursuites, non scellé la vérité. Elle n’interdit ni la mémoire ni la réclamation. Elle n’efface pas la responsabilité d’un État qui aurait condamné un homme pour avoir dit ce que la documentation publique confirmait.
Le danger serait de faire de cette situation une jurisprudence silencieuse, une manière d’entériner qu’un jugement, même erroné, doit rester intact pour préserver l’équilibre institutionnel. Un tel précédent ne protégerait pas la justice ; il entamerait sa légitimité. Il installerait dans le droit une zone d’immunité pour l’erreur, une tolérance pour le faux devenu définitif.
Ce qui se joue ici n’est pas la revanche d’un homme. C’est la capacité d’un système à se redresser. La République ne perd rien à corriger ce qu’elle aurait manqué. Elle y gagne en autorité. Une institution qui refuse d’écouter ce que les faits imposent s’expose à perdre, à terme, l’essentiel : la confiance.
La situation reste ouverte. Aucun recours n’a été déposé, mais l’argument est formulé. Il interpelle, à juste titre, la justice dans sa fonction la plus haute : celle de reconnaître quand un jugement mérite d’être revu, non pour céder, mais pour se conformer à la réalité. Si cette vérité est désormais établie, la question ne sera plus politique. Elle sera juridique. Et le droit devra y répondre.
Hady Traoré
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives