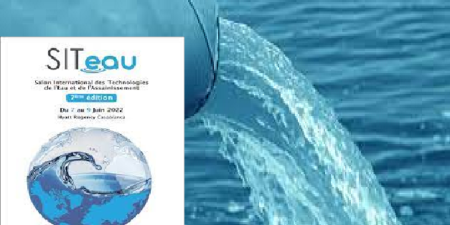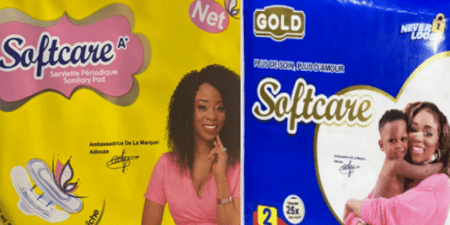- « La dette africaine ne provient que de la mauvaise gestion gouvernementale ».
Faux. Si certaines dettes peuvent résulter de politiques mal conçues, beaucoup sont le produit de chocs externes (comme les crises pétrolières, les fluctuations des prix des matières premières ou les pandémies), de pressions internationales ou encore de conditions économiques mondiales défavorables. De nombreux pays africains ont également hérité de dettes contractées sous des régimes autoritaires non démocratiquement élus.
- « Tous les pays africains doivent rembourser la totalité de leur dette. » Faux.
Faux. Comme pour tous les États, la dette publique est un flux continu : les emprunts sont régulièrement renouvelés, c’est-à-dire roulés. L’idée qu’elle doive être entièrement remboursée à zéro est irréaliste. Ce qui importe, c’est la capacité à gérer cette dette de manière soutenable.
- « La dette africaine est toujours extérieure et détenue par des créanciers étrangers. »
Faux. Si une grande partie de la dette est effectivement extérieure (emprunts auprès du FMI, de la Banque mondiale, de pays donateurs ou d’investisseurs privés), certains pays africains développent aussi une dette intérieure croissante via l’émission d’obligations locales.
- « Annuler la dette permettrait à l’Afrique de sortir de la crise ».
Faux (ou incomplet). L’annulation partielle ou totale de la dette peut soulager temporairement les budgets étatiques, mais sans réforme structurelle du système financier international, sans accès équitable aux marchés et sans financement alternatif, un développement durable n’est pas garanti.
- « La dette est toujours liée à l’austérité. »
Faux. Dans plusieurs pays africains, les politiques d’austérité imposées par les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale) sont souvent justifiées par la dette. Mais ces politiques ne sont pas une fatalité : elles reflètent des choix politiques privilégiant les intérêts des bailleurs de fonds plutôt que les besoins des populations.
- « La dette africaine est trop importante par rapport à son PIB »
Faux. Ce n’est pas le montant absolu de la dette qui est problématique, mais sa relation avec le PIB. Un pays peut avoir une dette élevée, mais être capable de la gérer s’il connaît une croissance économique suffisamment forte enrobée dans une bonne gouvernance. En Afrique, la faiblesse de la croissance économique, combinée à la volatilité des marchés et aux chocs climatiques et l’indiscipline budgétaire, rend la dette plus difficile à gérer.
- « Il faut réduire les dépenses publiques pour réduire la dette ». Faux !
Cette affirmation est économiquement fausse. Une réduction aveugle des dépenses publiques, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé ou des infrastructures, peut affaiblir la croissance économique. Toutefois, une dette bien utilisée peut stimuler l’économie si elle finance des projets productifs et socialement utiles.
- « La dette africaine est un héritage colonial »
C’est partiellement vrai, mais incomplet. Bien sûr, de nombreux pays africains ont hérité de dettes contractées pendant la période coloniale ou après l’obtention de leur indépendance, souvent dans des conditions inégales. Mais aujourd’hui, la dette provient également de nouveaux emprunts contractés pour faire face à des urgences économiques contemporaines.
- « La dette publique empêche le développement futur ».
Faux. Ce n’est pas la dette en soi qui est un frein, mais la manière dont elle est utilisée. Si les emprunts servent à financer des infrastructures, l’éducation ou l’agriculture durable, ils peuvent générer des retombées positives pour plusieurs générations.
- « Il suffirait de créer de la monnaie locale pour éviter l’endettement. »
Faux. Contrairement à ce que font certaines banques centrales occidentales (comme la BCE), les banques centrales africaines n’ont pas la même liberté de création monétaire indépendante, car leurs monnaies sont souvent peu valorisées et instables sur les marchés internationaux. Créer de la monnaie sans accompagnement institutionnel et économique peut mener à une inflation incontrôlée.
Cherif Salif Sy