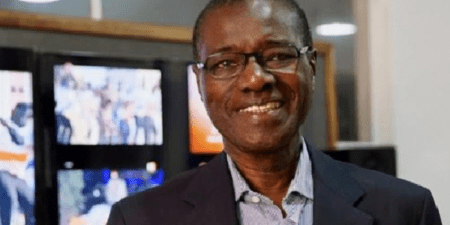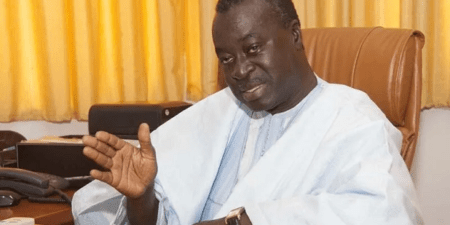Le résultat de l’élection présidentielle ivoirienne de 2025, donnant à Alassane Ouattara près de 90 % des suffrages exprimés, interroge la qualité démocratique du processus électoral et la vitalité du pluralisme politique en Côte d’Ivoire. Ce score, qualifié par certains observateurs de « soviétique », évoque les pratiques électorales des régimes autoritaires où l’élection se transforme en plébiscite.
Au-delà du résultat lui-même, cet événement réactive plusieurs questionnements fondamentaux : la nature du pouvoir en Afrique postcoloniale, la persistance des influences étrangères, notamment françaises, et les dérives potentielles d’une légitimation par la force du chiffre.
Dans une perspective politologique, cette situation peut être analysée à travers trois angles :
la crise de légitimité démocratique dans les régimes néo-patrimoniaux ;
la dépendance structurelle héritée de la relation postcoloniale franco-africaine ;
la recomposition des mobilisations citoyennes comme réponse à l’essoufflement institutionnel.
Le score de 90 % : entre plébiscite et déficit de concurrence
Un taux de 90 % des voix dans une élection pluraliste interroge, en premier lieu, la réalité de la compétition électorale. Selon Jean-François Bayart (1989), les régimes africains postcoloniaux s’appuient souvent sur une « politique du ventre », c’est-à-dire sur une distribution clientéliste des ressources de l’État pour entretenir la loyauté. Dans ce contexte, le vote n’est plus l’expression libre de la citoyenneté, mais un rituel de reconnaissance envers le détenteur du pouvoir.
En Côte d’Ivoire, la concentration du pouvoir exécutif entre les mains d’Alassane Ouattara depuis 2011 a conduit à une institutionnalisation de l’hégémonie : l’opposition, fragmentée et affaiblie, n’a pas pu présenter un front crédible. Le score massif du président sortant traduit donc moins une adhésion populaire qu’une érosion du pluralisme et une captation des instruments électoraux.
Comme le souligne Claude Ake (1996), « une démocratie sans opposition viable est une démocratie sans choix ».
La France et la logique de la dépendance postcoloniale
Le second axe d’analyse concerne la dimension internationale du pouvoir ivoirien. Depuis l’indépendance, la Côte d’Ivoire demeure un pivot du dispositif français en Afrique de l’Ouest. La notion de « Françafrique », conceptualisée par François-Xavier Verschave (1998), désigne cette toile d’intérêts économiques, diplomatiques et militaires qui a façonné la gouvernance des anciennes colonies.
Dans le cas ivoirien, les relations avec Paris ont toujours constitué un facteur d’équilibre, ou de tension, selon les conjonctures. Les opposants d’Ouattara l’accusent de préserver les intérêts français, notamment à travers la protection des entreprises hexagonales et des accords économiques asymétriques. Cette dépendance illustre la persistance d’un État extraverti (Bayart, 2006), où la légitimité interne se nourrit du soutien extérieur plus que de l’adhésion populaire.
Ainsi, le résultat « soviétique » du scrutin de 2025 peut aussi être lu comme une reconduction du pacte postcolonial, sous couvert de stabilité politique.
Le peuple face à l’inertie : vers une révolution citoyenne ?
Face à cette situation, une frange de la population ivoirienne exprime une forme de résignation politique, ce que Albert O. Hirschman (1970) qualifierait de stratégie d’« exit », le retrait silencieux plutôt que la confrontation ouverte. Pourtant, certains intellectuels et acteurs civiques appellent à une révolution, entendue non pas dans sa dimension violente, mais comme une refondation démocratique.
Dans la lignée des réflexions de Hannah Arendt (1963) sur la « révolution comme fondation de la liberté », il s’agirait moins de renverser le régime que de réinventer la citoyenneté : renforcer la société civile, exiger la transparence électorale et promouvoir des formes non-violentes de contestation. Les expériences récentes du Burkina Faso ou du Sénégal montrent que la mobilisation populaire peut infléchir les trajectoires politiques sans recourir à la guerre civile. Ainsi, la « révolution » souhaitée par certains analystes ivoiriens renvoie à une réappropriation du pouvoir symbolique par le peuple : observer, documenter, contester et proposer. Elle suppose une mutation culturelle où l’obéissance passive cède la place à une citoyenneté active et critique.
Le triomphe électoral d’Alassane Ouattara, par son ampleur, met en lumière les limites de la démocratie électorale en Afrique francophone. Derrière l’apparente stabilité, se dessinent les lignes de fracture d’un système politique en tension entre hégémonie présidentielle, dépendance postcoloniale et aspirations populaires à la souveraineté réelle. La Côte d’Ivoire se trouve, une fois encore, à la croisée des chemins : consolider un ordre politique autoritaire sous couvert d’efficacité, ou s’engager dans une transformation citoyenne fondée sur la responsabilité collective et la transparence.
Comme le rappelait Amartya Sen (1999), « le développement est avant tout une liberté ». C’est peut-être dans cette liberté, conquise pacifiquement par le peuple ivoirien, que réside la véritable révolution à venir.
PST