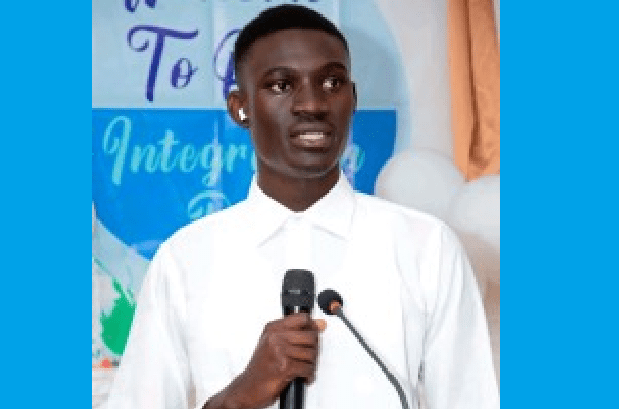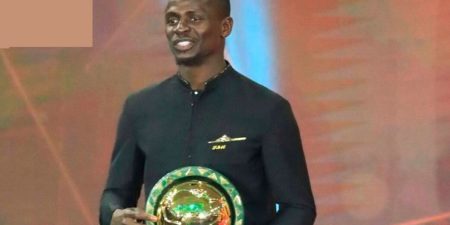Dans nos sociétés, les mots que nous utilisons pour parler des autres ne sont jamais neutres. Lorsqu’on commence à qualifier ses adversaires politiques par des épithètes dénigrantes ou des termes péjoratifs, on sort du débat d’idées pour entrer dans une logique de déshumanisation.
Au Sénégal, on entend de plus en plus, , et même à des niveaux élevés de responsabilité, des expressions comme « kulunas », « rats », « cafards » ou d’autres qualificatifs qui visent à discréditer les opposants ou gens du pouvoir. Cela peut sembler banal, on en rit parfois, les sympathisants en usent et abusent, et cela devient « accepté », mais l’histoire récente nous rappelle combien ces pratiques sont dangereuses.
Au Rwanda, avant le génocide de 1994, les Tutsis étaient régulièrement désignés par des mots déshumanisants comme « Inyenzi » (cafards). Cette rhétorique a progressivement préparé le terrain psychologique qui a rendu possible l’horreur.
En Europe, la propagande nazie utilisait des termes tels que « parasites » ou « vermine » pour parler des Juifs, créant un climat où leur élimination semblait légitime à certains.
Ces exemples montrent que la violence symbolique dans le langage précède souvent la violence physique. Elle installe une frontière entre « nous » et « eux », où l’adversaire n’est plus perçu comme un citoyen, mais comme un danger à éliminer.
Défendre des idées, débattre avec vigueur, critiquer des programmes : tout cela est normal et même sain dans une démocratie. Mais employer des insultes ou des termes déshumanisants fragilise notre vivre-ensemble et peut avoir des conséquences imprévisibles.
Les mots construisent des ponts ou des murs.
Soyons attentifs à ceux que nous choisissons.
Par Souley Wade