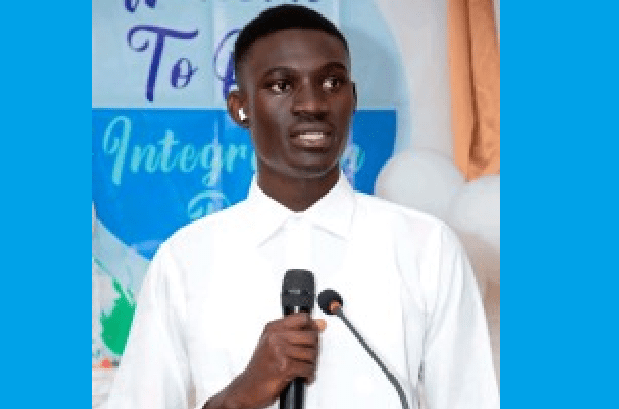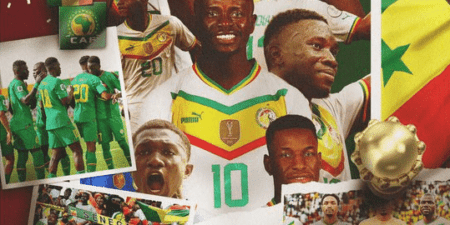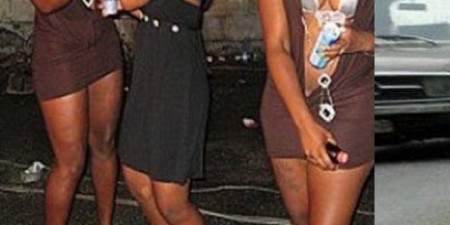Dans la gestion de la dette publique, les mots pèsent parfois plus lourd que les chiffres. Le Sénégal est entrain de l’apprendre à ses dépens. En qualifiant de « dette cachée » ce que le FMI appèlera plus prudemment des « données erronées » ou des « éléments non reportés », les nouvelles autorités ont confondu deux registres : celui du discours politique et celui du langage institutionnel.
L’intention affichée était louable, rompre avec le passé, démontrer la transparence, affirmer une rupture morale. Mais la méthode a trahi une méconnaissance ou tout au moins une mauvaise appréciation des codes diplomatiques et financiers. Dans les relations entre États et institutions internationales, chaque mot compte.
Parler de « dette cachée » dans un cadre médiatique peut séduire l’opinion, ou jeter l opprobre sur un régime précédent, voire engranger des dividendes politiques, à la veille d une élection cruciale. Mais dans un cadre institutionnel, c’est s’auto-incriminer. Et avant même que les rapports clés, les audits et autres vérifications, ne soient clôturés, c est reconnaître une faute, contre les intérêts du pays, avant même qu’elle ne soit établie.
Ce n’était pas aux autorités de qualifier, si prématurément, la nature de ces écarts. Et encore moins publiquement. Leur rôle était d’en constater l’existence, d’en informer les instances compétentes et d’engager le dialogue avec les partenaires techniques. En endossant lui -même, et très tôt , avant quiconque, ce vocabulaire chargé, le Sénégal a brouillé la frontière entre la communication politique et la rigueur technocratique. L’État s’est ainsi affaibli, livrant au FMI une position de force dans un moment critique.
L’intérêt supérieur du pays commandait, à ce moment, de faire tout pour préserver la continuité du programme avec le FMI. Dire la vérité en restant sur le terrain technique , celui de la vérification et de la sincérité des données, aurait fort probablement permis de corriger les écarts sans rupture, tout en maintenant la confiance des partenaires. La diplomatie économique exige du calme et de la précision, pas des gesticulations et effets d’annonce.
Le contexte s’est encore durci. Moody’s vient d’abaisser la notation souveraine du Sénégal à Caa1, avec perspective négative, invoquant des risques accrus de liquidité et une vulnérabilité budgétaire aggravée. Dans le même temps, le gouvernement a lancé de nouveaux emprunts obligataires, et une opération de titrisation des dettes de sociétés publiques, notamment celles de la Senelec, pour mobiliser de nouvelles ressources sur le marché régional. Ce double mouvement, déclassement international et recours à des mécanismes de financement d’urgence, illustre à quel point la marge de manœuvre s’est rétrécie : le pays emprunte plus cher, pour combler les failles d’un système fragilisé.
Face à ce déclassement, le ministère des Finances a réagi vivement, rejetant l’évaluation de Moody’s qu’il juge « spéculative, subjective et biaisée ». Le communiqué affirme que cette notation « ne reflète pas les fondamentaux de l’économie sénégalaise ni les réformes engagées ». Cette posture défensive est compréhensible, tout État cherche à protéger sa crédibilité. Cependant cela doit servir de piqûre de rappel et de remise en question. Le Plan de redressement économique et financier comporte des limites réelles, et la frénésie record sur les marchés régionaux peut susciter des appréhensions légitimes quant à l avenir.
Le FMI, de son côté, a su recadrer le débat et imposer son tempo, en privilégiant la formule de « données erronées », moins accusatrice mais plus contraignante sur le plan technique. Cette prudence sémantique lui permet de maintenir la coopération tout en renforçant ses exigences. En arrière-plan, certains partenaires, notamment la France, nouvellement « réconciliée », influente au sein du Conseil d’administration du Fonds, ont sans doute contribué à atténuer le choc et à faciliter une issue diplomatique. Sinon la pilule aurait certainement été encore plus difficile à avaler pour le Sénégal.
Le pays se retrouve désormais sous double tutelle, celle du FMI et des marchés. Le premier fixe les règles du redressement ; les seconds dictent les conditions du financement. De la souveraineté proclamée, on glisse vers une subordination accrue.
La leçon est claire : à ce niveau de responsabilité, la vérité ne suffit pas, il faut savoir la dire. La méthode, la mesure et la prudence ne sont pas des signes de faiblesse, mais les conditions mêmes de la crédibilité.
Encore faut-il que cette leçon serve vraiment.
Car pendant ce temps, on continue de se gargariser de bravades publiques, d’annonces d’investissements, et de promesses d’emplois, comme si la communication suffisait à conjurer la réalité.
Le danger est là : persister dans un monde fictif d’auto satisfaction, alors que la situation appelle un sursaut de lucidité et d’ancrage dans le réel.