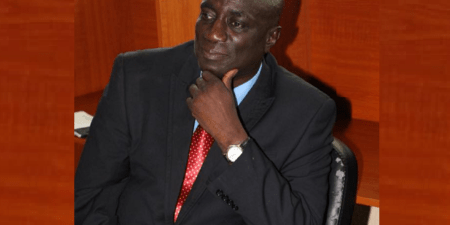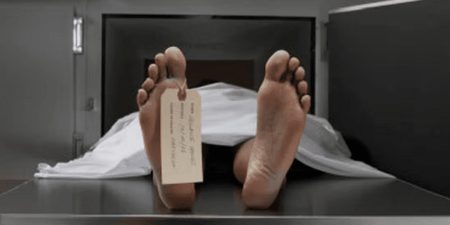En octobre 2005, sous le régime de Abdoulaye Wade, lors de la première alternance démocratique, SUD FM avait été temporairement fermée pour une journée. La raison : Ibrahima Gassama, correspondant à Ziguinchor, avait donné la parole à des membres du MFDC, alors retranchés dans le maquis. À l’époque, la plupart des médias et commentateurs, aujourd’hui prompts à dénoncer toute restriction, avaient applaudi cette décision.
Qu’est-ce qui a changé depuis ?
La loi n’a pas changé. La République est la même. Pourtant, le ton, les réactions et la mémoire collective semblent radicalement différents.
Sous Moussa Bocar Thiam, alors ministre de la Communication, de nombreux médias avaient vu leur signal coupé. Ces mêmes médias, pour beaucoup, se faisaient les porte-voix du pouvoir et ne bronchaient pas. Silence total.
Et quand, plus récemment, quand le pouvoir de Macky Sall exterminait les militants Patriotes, ces mêmes organes, aujourd’hui champions autoproclamés de la liberté de la presse, se sont autocensurés. Certaines chaînes, comme TFM, ont même choisi de diffuser de la musique pendant que le sang coulait. La télé de Youssou Ndour avait choisi la mélodie du silence.
Cette mémoire sélective et ce double standard sont préoccupants. La liberté de la presse ne doit pas se réduire à une posture opportuniste. Elle doit être cohérente et universelle, qu’il s’agisse de Wade, de Macky Sall, Diomaye ou Senghor ou de tout autre dirigeant.
Cette faits mettent en évidence une contradiction structurelle dans le champ médiatique sénégalais : la liberté de la presse est théoriquement garantie, mais son exercice est fortement modulé par la perception de légitimité du pouvoir en place et par des stratégies de préservation institutionnelle ou commerciale. Elle soulève également la question de la mémoire sélective, qui influence la narration historique et la construction de l’opinion publique.
En conclusion, la liberté de la presse au Sénégal ne peut être appréhendée uniquement par le prisme légal. Elle nécessite une analyse critique des pratiques médiatiques, de la mémoire politique et de l’indépendance effective des organes de communication. La cohérence entre principes et pratiques reste un enjeu majeur pour la consolidation démocratique du pays.