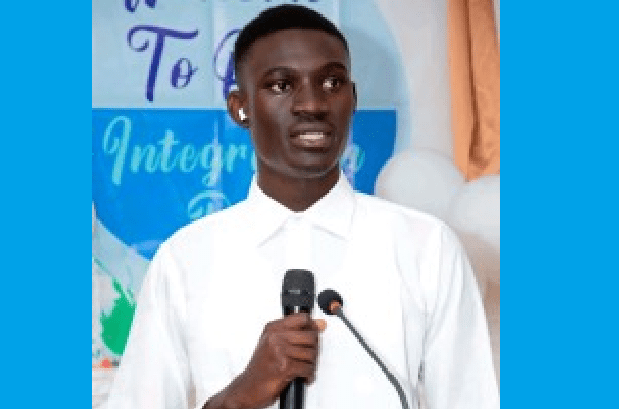Entre 2021 et 2024, notre pays a traversé de graves troubles politiques qui ont conduit à la mort de dizaines de personnes. Ces pertes tragiques ne peuvent rester sans réponse. Il est du devoir de la justice d’élucider les circonstances, d’identifier les responsables et de les sanctionner. Mais ce devoir ne peut être accompli que si les enquêtes couvrent toute la chaîne des responsabilités.
Or, c’est là que la loi d’amnistie pose problème. Certes, les crimes de sang et les actes de torture en sont exclus : le Sénégal, par ses engagements internationaux, ne peut en aucun cas les effacer. Ils seront donc poursuivis. Mais comment prétendre rendre justice aux victimes si, dans le même temps, les actes de subversion et de terreur, qui ont nourri la spirale de violence, restent protégés par l’amnistie ?
Avec une amnistie intacte, la vérité resterait tronquée et la justice incomplète. Les magistrats et auxiliaires de justice ne pourraient pas enquêter librement, donc établir l’ensemble des faits ni situer toutes les responsabilités. Le juge, pour sa part, n’aurait pas en main tous les éléments nécessaires pour apprécier correctement la culpabilité ou examiner des arguments tels que la légitime défense, la force légale, les mobiles de ces crimes présumés, ou encore les possibilités d’infiltration et de manipulation. Quant aux avocats de la défense, ils pourraient facilement invoquer le caractère incomplet des dossiers, conséquence directe d’enquêtes limitées par l’amnistie.
Les lenteurs reprochées à la justice trouvent peut-être leur explication ici : comment avancer pleinement lorsque des faits essentiels de cause à effet sont légalement soustraits à l’enquête ? La justice ne peut travailler dans l’orthodoxie de la loi si on lui interdit d’accéder à toute la vérité.
Voilà pourquoi il faut abroger la loi d’amnistie, en levant son effet de non-rétroactivité, afin que les faits déjà couverts puissent eux aussi être examinés. Seule une telle mesure permettra de garantir des enquêtes complètes et impartiales, et de rétablir l’équilibre entre mémoire, justice et vérité. Aux nouvelles autorités de trouver les voies juridiques et constitutionnelles pour rendre cela possible.
Mais la question est complexe. Car les nouvelles autorités elles-mêmes ont bénéficié de cette amnistie. L’abroger avec effet sur les faits déjà couverts reviendrait pour elles à accepter que la justice puisse enquêter sur leurs éventuelles responsabilités. Pourtant, c’est là que réside le véritable test : voulons-nous réellement la vérité et la justice dans leur entièreté, ou bien seulement des règlements de comptes politiques sous couvert de justice aux victimes ?
Car poursuivre les présumés coupables de crimes de sang et de torture, sans en même temps enquêter sur les actes présumés de subversion et d’atteinte à la sûreté de l’État qui ont contribué au climat de violence, reviendrait à pratiquer une justice sélective. Une telle démarche serait perçue, à juste titre, comme une justice des vainqueurs, et non comme une justice impartiale.
La seule voie crédible est donc de remettre les compteurs à zéro : que toute la vérité soit dite, que toutes les responsabilités soient établies, et que tous les coupables, quels qu’ils soient, soient sanctionnés.
Mettre fin à l’amnistie, en levant son effet de non-rétroactivité, est donc une étape indispensable pour restaurer la confiance, rendre la justice pleinement cohérente et ouvrir la voie à une réconciliation sincère.
Enfin, il appartient désormais à la société civile, aux représentants des victimes, aux acteurs politiques et à l’ensemble des citoyens de se mobiliser en front uni pour exiger cette réforme, afin que la vérité soit connue dans son intégralité, que la justice soit perçue comme impartiale et que la paix sociale puisse durablement s’enraciner.
Souley Wade