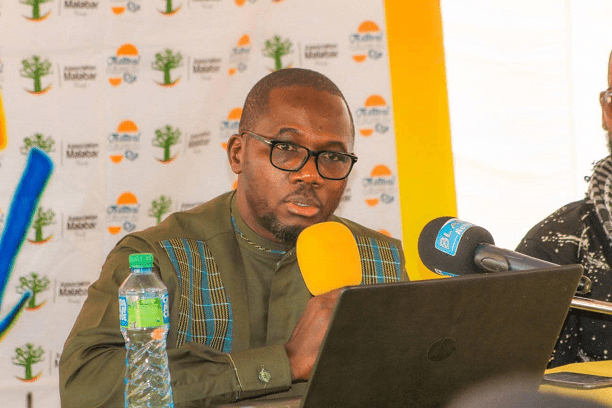Alors que les crises écologiques s’intensifient et que la transition verte devient un mot d’ordre international, la réflexion sur le développement reste piégée dans un cadre anthropocentrique. Pourtant, des alternatives existent et appellent à un changement de paradigme : reconnaissance des droits de la nature, écologie profonde, justice écologique, ou encore promotion de visions du monde autochtones fondées sur l’interdépendance entre les êtres.
Ces approches plaident pour dépasser l’anthropocentrisme, reconnaître à la nature une valeur propre et repenser le développement dans une perspective véritablement écologique et éthique.
Cette réflexion est un plaidoyer pour un changement de paradigme en profondeur : un développement fondé non plus uniquement sur le bien-être humain, mais sur une co-finalité intégrant de manière équivalente la santé des écosystèmes. Ce plaidoyer appelle les économistes, les scientifiques, les décideurs et les citoyens à repenser leurs rôles dans la construction d’un avenir réellement soutenable.
- L’humain au centre de tout
Le développement, tel qu’il est encore largement conçu aujourd’hui, demeure fondamentalement anthropocentrique. Il est défini comme un ensemble de transformations scientifiques, techniques/technologiques, politiques, sociales, économiques, culturelles etc., qui visent l’amélioration des conditions de vie humaines, tant sur le plan matériel, social, physique que moral ou spirituel.
Même lorsque l’on évoque des dimensions comme la durabilité ou l’environnement, c’est souvent dans une logique d’amélioration du bien-être humain que ces considérations sont convoquées.
Le modèle de développement dominant dans nos sociétés est ainsi profondément anthropocentré, c’est-à-dire centré sur l’humain, au détriment des autres formes de vie et des équilibres écologiques. Il conçoit le progrès comme une amélioration constante des conditions de vie humaines, mesurée par la croissance économique, l’accès aux biens, aux services et à la technologie, tout en reléguant la nature à un simple réservoir de ressources exploitables.
Même les approches dites durables, notamment les objectifs de développement durable, ne remettent pas en cause cette hiérarchie : elles visent surtout à garantir un environnement sain pour l’homme, sans considérer la valeur intrinsèque des écosystèmes.
Cette vision engendre des conséquences majeures : érosion de la biodiversité, dégradation des sols, pollution massive, disparition de nombreuses espèces, et affaiblissement de la résilience des milieux naturels. Les indicateurs de développement utilisés comme le PIB ou l’IDH ignorent presque totalement la santé des écosystèmes ou les limites planétaires. De plus, la nature n’est valorisée que dans la mesure où elle est utile à l’homme, comme en témoigne la notion de « services écosystémiques » qui reste, malgré ses avancées, une approche instrumentale.
- L’oubli des écosystèmes
Cette approche, qui place l’humain au centre de tout, traduit une séparation implicite entre l’homme et les écosystèmes, comme si ceux-ci n’étaient que des décors ou des ressources au service de l’épanouissement humain. L’une des preuves les plus manifestes de cette vision centrée sur l’humain est l’incapacité des politiques de développement à reconnaître l’humain comme un élément intégré des écosystèmes, à la fois dépendant et potentiellement destructeur de ces systèmes naturels.
- Pas de bien-être humain en dehors des écosystèmes
Le bien-être humain, aussi bien matériel que spirituel et moral, ne peut pourtant être envisagé en dehors des écosystèmes. Cette vérité essentielle a été occultée par les modèles successifs de développement, qu’ils soient précapitalistes ou capitalistes –, et plus encore par le modèle néolibéral dominant. Ce dernier a accéléré la destruction des écosystèmes, entraînant dans son sillage des crises écologiques majeures aux conséquences sanitaires, sociales, économiques et culturelles d’une gravité alarmante.
- L’impasse du « mainstreaming environnemental et climatique»
Face à ces désastres, des tentatives de correction ont émergé, cherchant à intégrer les enjeux écologiques dans les politiques de développement. Cette démarche, connue sous le nom de mainstreaming environnemental et climatique, consiste à insérer des considérations écologiques dans un modèle de développement qui reste, dans sa structure profonde, centré sur l’humain. Bien que cette approche constitue un progrès par rapport à l’indifférence totale qui a prévalu, elle demeure insuffisante.
- Greffe ou refondation ?
Le problème fondamental, c’est qu’on ne remet pas en question le cadre initial, avec la démarche du mainstreaming environnemental et climatique. En insérant des préoccupations écologiques dans un système anthropocentré, on se contente de greffer des éléments marginaux à un corps conceptuel déjà formé et dominateur. Le mainstreaming devient alors un bricolage, une tentative de réparation sans refondation, qui perpétue l’hégémonie de l’humain au détriment de l’équilibre global.
- Repenser l’économie à la racine
Ce plaidoyer appelle donc à un changement de paradigme profond et transversal, qui doit commencer par les disciplines qui structurent la pensée et les décisions en matière de développement.
Au premier rang de ces disciplines figure l’économie. Les économistes, souvent au cœur de la planification des politiques publiques, sont aujourd’hui appelés à une véritable révolution intellectuelle. Il est temps de reformater la pensée économique, de repenser l’économie non plus comme une science autonome de production, de transformation, de distribution et de consommation de richesses déconnectée des écosystèmes, mais comme une science indissociablement liée à la santé des écosystèmes, sous peine de voir l’économie comme activité disparaitre.
L’économie ne peut plus ignorer la valeur et l’intégrité écologique comme si les écosystèmes étaient des variables exogènes ou de simples externalités. Le monde a besoin d’économistes capables de comprendre les dynamiques écologiques, les cycles naturels, les capacités de régénération, mais aussi les seuils de rupture. Comprendre la valeur des écosystèmes et les coûts souvent irréversibles de leur dégradation doit devenir central dans la formation, la recherche et la pratique économique.
- Toutes les sciences doivent évoluer
Mais cette révolution ne peut s’arrêter à la science économique. Toutes les disciplines scientifiques sont concernées, car aucune activité humaine – qu’elle soit technologique, médicale, sociologique, sociale ou juridique – n’est sans impact sur les écosystèmes. Il est urgent que l’intégrité écologique, la vulnérabilité des milieux, leurs apports essentiels à la vie et à la stabilité des sociétés, soient intégrés dans la conception et la mise en œuvre de toutes les formes de science.
- Un tournant culturel et social
Le changement de paradigme attendu doit également s’étendre à la gouvernance politique, aux politiques publiques, mais aussi, et surtout, aux comportements sociaux. La manière dont les individus, les communautés et les institutions interagissent avec la nature doit profondément évoluer. Autant la reproduction sociale et économique est considérée comme une finalité légitime, autant la reproduction écologique – c’est-à-dire la capacité des écosystèmes à se maintenir, se régénérer et prospérer, doit devenir une priorité structurante de nos comportements collectifs.
- Vers une nouvelle co-finalité du développement
Il ne s’agit plus simplement de « protéger les écosystèmes», mais de reconnaître que tout projet humain, qu’il soit économique, social, politique, culturel ou spirituel, repose sur des fondations écologiques. À ce titre, l’intégrité, la santé et le bien-être des écosystèmes doivent être considérés comme des objectifs aussi fondamentaux que ceux liés à l’épanouissement humain.
- Pour un développement soutenable pour les écosystèmes dans l’avenir
Il est temps d’opérer un véritable basculement conceptuel : décentrer l’anthropocentrisme du développement. Cela signifie repenser les finalités du développement non plus uniquement à l’aune du bien-être humain, mais en intégrant de manière équivalente le bien-être des écosystèmes. Mieux encore, il faut reconnaître que l’un ne peut aller sans l’autre.
La coexistence entre bien-être humain et bien-être écologique ne peut être une relation hiérarchisée, où l’environnement serait subordonné aux besoins de l’homme. Il s’agit d’une co-finalité : toute politique de développement véritablement soutenable doit viser simultanément ces deux objectifs.
Cela implique de revoir nos priorités de développement à la racine. Il ne suffit plus d’« insérer » des préoccupations écologiques dans des logiques humaines préexistantes ; il faut que ces préoccupations deviennent structurantes, fondatrices. Le développement ne doit plus être une trajectoire de transformation de l’humain « dans son monde », mais une co-évolution de l’humain dans son milieu, en interdépendance avec les autres formes de vie.
Décentrer l’anthropocentrisme, ce n’est pas nier la dignité humaine ni la légitimité de rechercher l’épanouissement de nos sociétés. C’est au contraire reconnaître que cet épanouissement ne peut être authentique ni durable s’il se construit contre ou en dehors des écosystèmes. Il est temps de sortir d’un développement à sens unique pour entrer dans une dynamique de réciprocité écologique. C’est là, et seulement là, que peut s’inventer un avenir soutenable.
Nous ne construirons pas un avenir soutenable en greffant des considérations écologiques à un modèle de développement centré sur l’humain. Il est temps de sortir du bricolage et de refonder nos priorités : placer le bien-être des écosystèmes au même niveau que celui des humains, repenser l’économie, transformer la science, revoir la gouvernance, et réorienter nos comportements. Car il n’y a pas d’humanité viable sans milieux vivants sains.
Par Dr Aliou Gori Diouf,
Spécialiste en planification climatique et développement durable
aliou.diouf@gmail.com