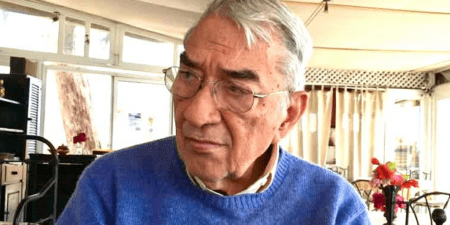Alors que l’ancien président Macky Sall affirme que des dettes cachées sont « impossibles » sous le contrôle de la BCEAO et du FMI, l’actuel pouvoir sénégalais parle d’écarts massifs, d’audits révélateurs et d’une dette approchant les 119% du PIB. Retour sur une controverse qui dépasse les frontières sénégalaises et interroge les limites des garde-fous financiers internationaux.
La polémique enfle dans le pays de la Téranga. D’un côté, l’ancien chef de l’État, Macky Sall, défend son bilan et clame, catégorique : la constitution de dettes cachées est une « impossibilité technique et juridique ». Il invoque le contrôle permanent et rigoureux de deux institutions phares : la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et le Fonds Monétaire International (FMI). De l’autre, le régime du président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko brandissent les résultats d’audits préliminaires, dénoncent des « non-conformités majeures » dans la gestion des comptes publics et évoquent une dette publique bien plus lourde qu’annoncée, flirtant avec les 119% du PIB. Qui dit vrai ? Au-delà de l’affrontement politique, cette querelle soulève une question fondamentale : est-il vraiment impossible pour un État de dissimuler une partie de son endettement, même sous le regard supposé vigilant de la BCEAO et du FMI ?
La thèse de l’impossibilité : les garde-fous invoqués
L’argumentaire de l’ancien pouvoir repose sur une architecture financière considérée comme infaillible.
- Le rôle de la BCEAO : Dans l’UEMOA, les États membres ne peuvent pas « créer de la monnaie » en contractant des dettes directement auprès de leur banque centrale, comme cela peut être le cas ailleurs. Ils doivent emprunter sur les marchés financiers ou auprès de bailleurs. La BCEOA supervise le système bancaire et, en théorie, les flux financiers. Toute opération de dette souveraine majeure transite nécessairement par le système bancaire, qui est sous sa surveillance.
- Le contrôle du FMI : L’institution de Washington impose des conditionnalités strictes dans le cadre de ses programmes d’aide. Des revues trimestrielles ou semestrielles examinent en détail la situation des finances publiques, le niveau d’endettement et le respect des critères de convergence de l’UEMOA (dont le fameux plafond de 70% du PIB pour la dette). Toute dette non déclarée serait, selon cette logique, immédiatement détectée lors de ces audits réguliers.
Sur le papier, le système semble étanche. Pourtant, l’histoire récente et les mécanismes financiers opaques démontrent que cet optimisme est peut-être excessif.
La réalité des dettes cachées : un phénomène mondial et africain
La notion de « dette cachée » n’est pas une invention sénégalaise. Elle désigne un endettement public qui n’est pas correctement enregistré dans les documents budgétaires et les statistiques officielles, souvent dissimulé dans les comptes d’entreprises publiques ou via des instruments financiers complexes.
- Le cas emblématique du Mozambique (2013-2016) : C’est l’exemple parfait d’un État ayant réussi à cacher plus de 2 milliards de dollars de dettes. Le gouvernement a garanti des emprunts contractés par trois entreprises publiques (ProIndicus, EMATUM et MAM) pour des projets de sécurité maritime et de pêche. Ces dettes, présentées comme privées, n’apparaissaient pas dans les statistiques de la dette publique. Le FMI et les créanciers internationaux n’ont été informés que tardivement, provoquant un scandale, un défaut de paiement et une suspension de l’aide internationale. Le FMI lui-même a reconnu des « failles » dans son système de surveillance.
- L’exemple de la République du Congo (2017) : Le pays a été accusé d’avoir dissimulé une partie de sa dette à l’égard du trader suisse Glencore, empêchant ainsi une vision claire de sa soutenabilité budgétaire. Là encore, des créances pétrolières anticipées et des prêts directs n’étaient pas pleinement transparents.
- Les « prêts garantis » et les PPP (Partenariats Public-Privé) opaques : Un des moyens les plus courants pour contourner les plafonds d’endettement est de recourir à des garanties de l’État sur des emprunts contractés par des entités parapubliques. Tant que l’entreprise publique rembourse, la dette reste « hors bilan ». Mais en cas de défaut, elle retombe intégralement sur les épaules de l’État, comme une bombe à retardement. Les PPP mal structurés peuvent fonctionner sur le même principe.
Comment dribbler la BCEAO et le FMI ? Les mécanismes du contournement
Il est naïf de croire que ces institutions sont omniscientes. Leurs contrôles, bien que rigoureux, ont des limites que des acteurs déterminés peuvent exploiter.
- L’ingénierie financière et les créanciers « parallèles » : Le FMI et la BCEAO s’appuient sur les données fournies par les États membres. Si un gouvernement contracte un prêt avec un créancier privé peu scrupuleux, une banque d’affaires ou un fonds vautour, et convient de ne pas le déclarer immédiatement, l’opération peut passer inaperçue un temps. Les créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris peuvent également opérer dans une relative opacité.
- Le recours aux entreprises publiques (le « modèle mozambicain ») : C’est le canal privilégié. L’État fait contracter la dette non pas directement par le Trésor public, mais par une société d’énergie, de transport ou de télécommunications. La dette est ainsi comptabilisée au bilan de l’entreprise. La BCEAO surveille le secteur bancaire, mais le lien entre un prêt à une entreprise publique et une garantie de l’État implicite ou explicite peut être obscurci. L’audit du FMI se concentre sur la dette du gouvernement central ; il faut un examen plus poussé pour consolider la dette du secteur public élargi.
- Les arriérés de paiement et la dette « flottante » : Un État peut accumuler des arriérés de paiement auprès de ses fournisseurs nationaux (entreprises de BTP, fournisseurs de carburant). Ces arriérés, qui constituent une forme de dette, ne sont pas toujours captés instantanément par les statistiques en temps réel. Ils gonflent la dette réelle sans être immédiatement visibles.
- Le décalage temporel et la complexité comptable : Il existe un délai entre la signature d’un contrat de prêt, son décaissement et son enregistrement dans les livres de comptabilité publique. Un audit comme celui du FMI est un instantané. Des engagements fermes pris juste après une revue peuvent rester dans l’ombre jusqu’à la revue suivante, six mois plus tard. De plus, la complexité délibérée de certains instruments financiers (prêts indexés sur des matières premières, swaps de taux) peut brouiller les pistes.
Le cas sénégalais : entre soupçons, audits et réalités comptables
C’est dans ce contexte qu’il faut analyser les déclarations contradictoires à Dakar.
- Les allégations du nouveau pouvoir : Le gouvernement « Diomaye-Sonko » s’appuie sur les travaux de l’audit dit « MOZAR » (Mission d’Optimisation et de Vérification des Acquisitions et des Recouvrements) et d’autres examens des finances publiques. Ils pointent du doigt :
- Des dépassements systématiques des procédures de passation des marchés.
- Une non-consolidation de dettes d’entreprises publiques qui engageaient la responsabilité de l’État.
- Des engagements hors bilan qui n’apparaissaient pas dans le calcul du ratio d’endettement officiel.
L’objectif affiché est de dresser un état des lieux « véridique » de la situation financière du pays, qui serait bien plus alarmante que celle présentée jusqu’alors.
- La défense de l’ancien régime : L’équipe de Macky Sall rétorque que toutes les opérations étaient légales, validées par les institutions compétentes et transparentes.
En conclusion : Une question de volonté politique, pas seulement de contrôle technique.
L’affirmation selon laquelle des dettes cachées sont « impossibles » ne résiste pas à l’épreuve des faits historiques et des mécanismes financiers. La BCEAO et le FMI sont des institutions puissantes, mais elles ne sont pas omnipotentes. Leur efficacité dépend en grande partie de la bonne foi et de la transparence des États qu’elles sont censées surveiller: la culture de la conformité.
La révélation de dettes dissimulées au Mozambique, en Congo ou ailleurs, souvent par le biais de nouveaux gouvernements procédant à des audits, prouve que le système peut être contourné. La clé ne réside donc pas seulement dans le contrôle externe, mais dans la gouvernance interne, la transparence absolue dans la passation des marchés et la responsabilisation des dirigeants.
La polémique au Sénégal est plus qu’une simple querelle politicienne. Elle est le symptôme d’un enjeu crucial pour l’Afrique : la conquête d’une souveraineté financière fondée sur une gestion irréprochable des deniers publics, hélas ! c’était pas le cas pour les régimes précédents au Sénégal. Elle rappelle, amèrement, que les chiffres officiels ne disent pas toujours toute la vérité, et que la lumière des audits est souvent la seule à pouvoir dissiper l’ombre des dettes cachées. L’avenir économique du Sénégal, et sa crédibilité auprès des investisseurs, dépendront de la capacité de toutes les parties à faire toute la transparence sur ce dossier brûlant. Au demeurant, le FMI devrait jouer le jeu à travers un nouveau programme pour l’État du Sénégal et in fine, dépasser cette séquence de turbulence socio-économique de déclarations erronées et/ ou de de dette cachée.
Dr. Seydina Oumar Seye.