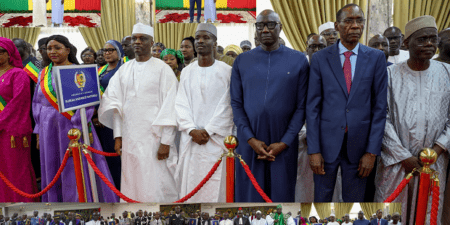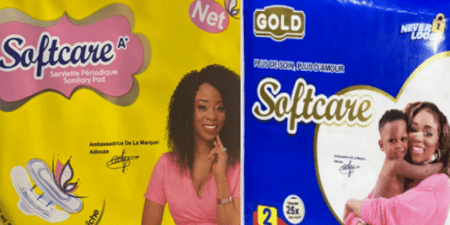La diaspora sénégalaise a toujours occupé une place singulière dans la vie nationale. Force économique par ses transferts financiers, relais social par ses solidarités, miroir critique par ses mobilisations, elle n’avait pourtant jamais été pleinement reconnue comme acteur stratégique du destin collectif.
La rencontre de Monza, en Italie, a changé cette donne. En y présentant le Plan de Redressement Économique et Social (PRES), adopté par le gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko a inauguré une nouvelle étape dans la relation entre l’État et ses citoyens établis hors des frontières. Ce moment a transformé un document technocratique en projet commun, en scellant un pacte inédit entre le gouvernement et ses communautés dispersées.
Une interrogation domine : comment un plan conçu au sommet peut-il devenir une dynamique partagée par toute la nation ? Ce week-end a révélé une triple exigence, indissociable de tout projet collectif : communiquer avec clarté, incarner avec cohérence et susciter l’appropriation. C’est cette trilogie : politique et symbolique, économique et sociale, géopolitique et identitaire que révèle le pacte issu de cette tribune italienne.
L’adhésion est d’abord née de l’incarnation. Présenter un plan exigeant, fondé sur la discipline et la rigueur, aurait pu susciter réserve ou scepticisme. Or, le discours prononcé n’était pas celui d’un technicien, mais d’un leader. Par la cohérence entre son parcours, ses valeurs et ses actes, Sonko a donné au PRES une dimension qui dépasse la technique : il a transformé la rigueur en espérance.
La mobilisation fut l’illustration éclatante de cette résonance. L’Arena, saturée au-delà de ses
5 000 places, s’est muée en agora nationale hors frontières, où la diaspora a signé son adhésion au plan de redressement. Ce n’était plus seulement une salle comble, mais une assemblée symbolique, une démonstration de volonté collective.
Ce moment a confirmé un basculement : les Sénégalais de l’extérieur ne veulent plus se limiter à leurs transferts financiers. Ils revendiquent une participation active, faite d’expertise, de réseaux et de vision stratégique. En les associant au PRES, l’État reconnaît que la nation ne se définit pas par ses seules frontières : elle se déploie dans une dynamique transnationale où chaque citoyen, où qu’il vive, peut être co-architecte de l’avenir.
En l’espace d’un week-end, un signal inédit a été donné : la diaspora n’est plus périphérique, mais centrale. Longtemps réduite à ses envois de fonds, elle est désormais reconnue comme une force dispersée mais stratégique. Ce geste consacre l’idée que, de Paris à New York, de Dakar à Milan, d’Istanbul à Abidjan, de Taipei à Putrajaya, chaque communauté compte dans la définition de l’avenir du pays. En une journée, l’Arena est devenue centre de gravité nationale, restituant une dignité politique à des parcours longtemps relégués.
Les autorités l’ont compris : le partenariat avec la diaspora ne peut être marginal. En instituant le 17 décembre comme Journée nationale de la diaspora, elles ont inscrit cette reconnaissance dans le calendrier républicain. Les futurs instruments financiers, tels que les diaspora bonds ou patriots bonds envisagés dans le cadre des prochains Appels Publics à l’Épargne (APE), constituent également des jalons concrets de cette intégration, en transformant l’attachement symbolique en levier de développement national.
Ce rassemblement a aussi résonné comme un acte démocratique. En donnant directement la parole aux citoyens établis hors du pays, l’État a rappelé que la souveraineté n’est pas seulement institutionnelle mais populaire. Dans une époque où la confiance entre gouvernés et gouvernants se fragilise, le geste consistant à partager la stratégie nationale avec ceux de l’extérieur a valeur d’engagement. Il ne s’agissait pas d’une communication descendante, mais d’un appel à la co-construction. Le PRES devient ainsi non seulement un instrument de redressement économique, mais aussi une nouvelle méthode politique : gouverner en associant, plutôt qu’en décrétant.
La portée de l’événement a été démultipliée par la circulation numérique. Les images et les discours ont franchi les frontières, relayés par les réseaux sociaux, amplifiés par la presse, commentés dans les foyers. Ce qui s’est joué en Italie s’est transformé en conversation mondiale. La diaspora contemporaine n’est pas seulement dispersée : elle est connectée, productrice d’opinion et force d’influence. Ainsi, ce pacte n’est pas qu’un moment politique : il est une expérience de démocratie transnationale.
La diaspora, en se ralliant à ce plan, se positionne aussi comme un contre-pouvoir moral. Éloignée du quotidien politique national, elle dispose d’une distance critique qui lui permet de rappeler sans relâche les exigences d’intégrité, de transparence et d’efficacité. Ce rôle, assumé depuis longtemps dans les luttes démocratiques, prend une nouvelle forme avec le PRES : la diaspora n’est plus seulement un observateur vigilant, mais un partenaire dont l’adhésion engage aussi la responsabilité. En d’autres termes, l’appui de l’extérieur devient une garantie supplémentaire contre les dérives internes.
La dimension générationnelle ajoute une autre profondeur. Qu’ils soient issus directement de l’immigration ou nés dans les pays d’accueil, beaucoup se sont reconnus dans ce projet. Tous ont trouvé dans le PRES un cadre d’appartenance et une perspective d’engagement. C’est un fait majeur : un projet qui attire la jeunesse dépasse l’effet d’une campagne, il acquiert une longévité qui traverse les cycles politiques.
L’une des forces du PRES, telle qu’expliquée devant la diaspora, est de replacer l’action publique dans une temporalité de résultats. Là où les promesses électorales se perdaient souvent dans l’attente, le nouveau pacte insiste sur la logique des livrables. Pour des citoyens habitués à comparer leur pays d’origine aux systèmes dans lesquels ils vivent, ce langage du concret est un facteur de crédibilité. Ce basculement temporel – du rêve au résultat, du discours à l’action est au cœur de la confiance qui s’est manifestée à Monza. Il constitue aussi un avertissement : cette confiance se mesurera à l’épreuve des faits.
Sur le plan international, ce rassemblement a envoyé un signal clair. Dans un monde où l’Afrique redéfinit ses alliances et affirme sa souveraineté, voir un Premier ministre sénégalais mobiliser sa diaspora autour d’un plan crédible est une démonstration de légitimité : celle d’un projet qui s’enracine dans l’adhésion de son peuple, où qu’il se trouve. L’événement envoie aux partenaires un signal fort : le Sénégal s’appuie sur une diaspora capable de soutenir, de défendre et de relayer ses choix stratégiques. La souveraineté ne s’affirme plus seulement dans les négociations diplomatiques, mais aussi dans la capacité d’un État à mobiliser ses propres forces au-delà de ses frontières.
L’histoire comparée des nations illustre cette portée. Le Rwanda, l’Éthiopie ou le Ghana ont montré que la diaspora pouvait être un levier décisif de puissance et de reconstruction. Le Sénégal, avec ce pacte, entre dans cette logique : transformer une dispersion en force structurée, une nostalgie en projet, une distance en influence. Mais pour inscrire cette dynamique dans la durée, il faudra aussi aller plus loin : mécanismes financiers innovants, dispositifs institutionnels adaptés et suivi rigoureux – autant d’instruments appelés à transformer ce lien retrouvé en force durable.
Enfin, la rencontre en terre italienne doit être lue à la lumière du temps long. Elle prolonge des décennies de sacrifices, d’éloignement et de nostalgie vécus par des générations de migrants sénégalais. Elle consacre surtout un basculement historique : ce qui était périphérique devient central, ce qui était considéré comme additionnel devient constitutif. L’histoire retiendra que le redressement du Sénégal a trouvé dans l’énergie de ses fils et filles dispersés une colonne vertébrale nouvelle.
L’adhésion a été éclatante. Mais elle ne suffira pas. Un pacte, pour durer, doit franchir l’épreuve du réel. Il faudra transformer l’élan en instruments concrets : fonds d’investissement, obligations de la diaspora, projets productifs ; et garantir la transparence qui en fera un levier de confiance. Il faudra aussi convertir la mobilisation en résultats tangibles : routes, écoles, emplois, justice. Sans livrables visibles, la confiance, aussi vive soit-elle, peut s’éroder.
À cela s’ajoute un enjeu psychologique : préserver la fierté retrouvée d’une communauté longtemps reléguée, sans la décevoir. L’enthousiasme de ce jour est une promesse, mais une promesse exigeante. L’action publique est un marathon, non un sprint. La mobilisation doit devenir trajectoire, non parenthèse. Enfin, la cohérence sera décisive : le PRES appelle discipline et constance, et chaque contradiction pourrait en éroder l’esprit.
Si ces conditions sont réunies, cette rencontre ne restera pas un simple moment d’enthousiasme. Elle entrera dans la mémoire politique comme le moment où l’État et sa diaspora ont choisi de se relever ensemble, dans la vérité, l’adhésion et la responsabilité.
Loin d’être une périphérie, la diaspora s’est révélée centre de gravité nationale. Et c’est de ce centre élargi que le Sénégal tirera désormais sa force. Mais cette démonstration a aussi un nom : celui d’un Premier ministre qui a su transformer la ferveur en pacte, et un plan en horizon. En incarnant la cohérence et la détermination, Ousmane Sonko a rappelé qu’un leadership authentique ne se mesure pas au pouvoir détenu, mais à la capacité de rallier une nation autour d’un projet partagé.
Hady Traoré
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com