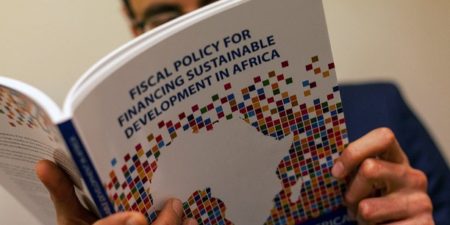La riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans le Walo, aurait pu être une bénédiction nationale. À elle seule, cette région, dotée d’un potentiel agroécologique exceptionnel, est capable de nourrir le Sénégal en riz local de qualité. Pourtant, chaque saison culturale s’accompagne du même refrain : accès difficile aux terres, semences de mauvaise qualité, intrants hors de prix ou livrés tardivement, manque de mécanisation, problème chronique d’écoulement du riz paddy, et attaques d’oiseaux granivores dévastateurs.
Une production sous pression
Cette année encore, des centaines d’hectares ont été décimés par les oiseaux, notamment les quelea quelea, malgré les efforts de la SAED et des coopératives locales. Pour les producteurs, c’est la double peine : ils perdent leurs récoltes et doivent encore rembourser des crédits contractés pour les campagnes agricoles. Le manque d’un plan national durable de lutte contre les oiseaux pose question, tout comme l’insuffisance des moyens aériens et techniques déployés.
L’impasse de l’accès à la terre
Dans le Walo, l’accès à la terre est un nœud foncier douloureux, pris entre droits coutumiers, attribution par les collectivités territoriales, et occupation de fait. De nombreux producteurs déplorent des affectations non transparentes ou des monopoles concentrés entre les mains de quelques grands exploitants. Le rêve de l’autosuffisance alimentaire se brise souvent sur ces réalités locales.
L’écoulement : une autre guerre
Même quand la production est bonne, l’écoulement du riz paddy reste un véritable cauchemar. Les usines de décorticage sont souvent saturées, le prix au kilogramme est dérisoire, et les producteurs manquent de pouvoir de négociation face aux grands commerçants. L’État peine à réguler efficacement la filière ou à garantir un prix plancher juste. Pendant ce temps, le riz importé continue d’inonder les marchés sénégalais, au détriment de la production nationale.
Ce que l’État doit faire
Malgré les efforts visibles de la SAED, force est de constater que l’État doit assumer son rôle de stratège et de régulateur: Mettre en place un plan d’urgence multisectoriel pour sauver la filière riz dans le Walo, renforcer la lutte contre les oiseaux à travers des moyens technologiques et la coordination régionale avec les pays du bassin, réformer l’accès à la terre pour plus d’équité et de transparence, créer un fonds de stabilisation des prix du paddy et soutenir le stockage et la transformation locale,
encadrer les producteurs avec un vrai dispositif de suivi, d’encadrement technique et de mécanisation.
Le paradoxe est cruel : alors que le Sénégal aspire à l’autosuffisance alimentaire, ses riziculteurs du Walo se battent chaque jour contre l’abandon, les aléas climatiques et les prédations aviaires. Il est temps que les autorités passent des discours aux actes. Car tant qu’un agriculteur dort l’angoisse au ventre, aucun développement durable ne pourra germer.
Babou Birame Faye